Par João Bernardo
Traduit par Yves Coleman à partir de l’original portugais publié ici.
MOTS CLES [1] : identitarismes et nationalismes ; écologie et fascisme ; mouvements afrobrésiliens ; «mâle blanc hétéronormé occidental» et «antirace» ; postfascismes et identitarismes ; classe capitaliste des gestionnaires [*] [2] ; gauche et classe ouvrière
L’écart croissant entre la définition économique de la classe ouvrière et son indéfinition sociologique a permis à la somme des identités de remplacer la classe ouvrière.
1
Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée et, avec elle, les autres régimes de sa sphère d’influence, Rita Delgado [3] m’a dit qu’elle regrettait la manière dont cela s’était passé. Selon elle, le fait que la fin du capitalisme d’État soviétique ait été dictée par une implosion des élites, et non par un processus révolutionnaire engendré et dirigé par les travailleurs représentait une grande défaite.
Les années suivantes ont montré que le problème était encore plus grave.
Un processus révolutionnaire international, qui avait commencé en 1915-1916 dans les tranchées françaises et allemandes et s’était rapidement étendu à toute l’Europe, s’est finalement limité à la Russie, où le parti léniniste annonça qu’il allait remodeler la société et l’économie. Au lieu de transformer la société, il transforma les membres du parti qui, de militants internationalistes, devinrent des bureaucrates nationalistes. Quant à l’économie, les travailleurs restèrent ce qu’ils étaient et les membres du parti se convertirent en gestionnaires [*] . Lorsque les groupes d’extrême gauche célébrèrent le centenaire de la prise du pouvoir par les bolcheviks, je n’ai pas vraiment compris ce qu’ils célébraient.
L’économie soviétique, dans laquelle l’État prétendait constituer un marché unique en s’assurant une position monopolistique, reposait uniquement sur l’existence d’une myriade de marchés parallèles. A l’opinion publique, on présentait les plans économiques et leurs réalisations. Mais en coulisses, une multitude d’entrepreneurs illégaux achetaient les produits dans les secteurs qui avaient des excédents par rapport au plan et les revendaient dans les endroits où ces biens manquaient ; de plus, les petits producteurs de denrées alimentaires permettaient aux estomacs d’être moins vides que les rayons des supermarchés ; enfin, des individus débrouillards travaillaient à leur compte quand survenait une pénurie de main d’œuvre non prévue par le plan. Bref, le mythe d’une économie d’État monopolistique et planifiée, obéissant au rythme lent des décisions bureaucratiques, ne s’effondra pas que parce qu’elle était soutenue par, ou s’appuyait sur, une économie illégale, versatile et très rapide. Tous le savaient, mais la censure et le contrôle idéologique suffisaient pour que tous fassent semblant de ne pas la voir.
Durant les dernières années du régime soviétique, l’élite dirigeante tenta d’harmoniser officiellement ces deux structures économiques, mais sans succès : la fiction était devenue trop fragile et transparente pour peser face à la réalité [4] .
Les privatisations qui suivirent l’effondrement du régime soviétique furent financées par des capitaux accumulés dans l’économie illégale et parallèle, et qui s’emparèrent des entreprises et des mécanismes de l’économie légale. Le chaos apparent des premières années du nouveau régime et le gangstérisme qui régnait alors dans les rapports économiques furent l’expression la plus scandaleuse du remplacement des disputes bureaucratiques à huis clos par des affrontements entre capitaux nés dans l’illégalité et ne connaissant d’autre style que celui de la délinquance.
Pendant tout ce processus, comme le déplorait Rita Delgado, les travailleurs n’eurent d’autre rôle que celui de travailler. A l’époque, nous, les militants d’extrême gauche, étions remplis d’illusions : nous croyions que notre tour était venu et que la révolution était là, à portée de main ! Nous pensions être l’opposition au régime soviétique et cette conviction était notre raison d’être, mais finalement l’histoire nous a relégués au rang de simples appendices.
Lorsque l’Union soviétique s’effondra, l’extrême gauche s’effondra avec elle. Cet effondrement a eu des conséquences dévastatrices et a dicté toute la situation actuelle. Le programme de cette gauche était social ou, plus exactement, socio-économique, et, pour l’extrême gauche, les rapports de travail étaient au cœur de l’économie et de la société. Toute notre critique du régime soviétique provenait du fait que nous considérions que ce régime avait changé les rapports juridiques de la propriété, mais pas les rapports sociaux du travail. Et en affirmant que l’essence de la révolution serait la transformation des rapports de travail, nous tirions les leçons des mouvements pour l’autonomie, durant les années 1960 et 1970, qui connurent leurs derniers épisodes au Portugal et en Pologne. Mais lorsque le cours de l’histoire a aboli l’extrême gauche en même temps que le capitalisme d’État soviétique que nous combattions, il a aboli également la place centrale que nous avions accordée au problème des rapports de travail. La gauche sociale et économique a disparu, et à sa place est apparu brusquement un mouvement complètement différent. Une nouvelle époque s’est ouverte.

Mais tout d’abord, qu’est-ce que j’appelle ici la «gauche» ? Les définitions rigoureuses ont d’énormes avantages, sinon nous n’aurions pas besoin de dictionnaires, et elles sont souvent indispensables. Mais elles ont aussi des inconvénients, lorsqu’elles opèrent des coupes arbitraires dans une réalité fluide et dans un cours du temps ininterrompu. La gauche à laquelle je me réfère ici n’est pas seulement celle qui se proclame telle aujourd’hui, mais aussi celle qui est liée à la gauche qui a existé ou qui est sur le point de disparaître. Le doute lui-même sur le sens du mot fait partie de la gauche, et la dynamique de cet essai découle de ce doute.
Or, les marxistes, qui se targuent d’utiliser une méthode scientifique d’analyse de la réalité et considèrent que la bonne idéologie, la leur, dicte la bonne pratique, devraient réfléchir un peu au fait qu’ils n’ont fait qu’accumuler les échecs, tandis que les capitalistes, réduits à un pragmatisme à court terme, ont remporté et remportent des victoires successives. Le constat est encore pire : les fiascos des marxistes sont dus à leurs contradictions internes, tandis que les contradictions internes tant vantées du capitalisme ont engendré des processus de destruction créatrice et ont donc contribué à assurer le développement du capital. Les théories, les grandes théories globales, ne sont-elles que des ballons remplis d’air dépourvus d’influence sur la pratique ?
La question est plus profonde, ou peut-être même différente. Peu après l’effondrement du régime soviétique, je me trouvais avec un groupe d’amis à São Paulo, parmi lesquels Fernando Prestes Motta, prématurément décédé, et nous écoutions les Quatre derniers lieder de Richard Strauss. Quelqu’un a rappelé la sympathie réticente du compositeur pour le nazisme, qui l’avait conduit pendant quelques années à présider la Reichsmusikkammer, et j’ai fait remarquer que cette œuvre devrait être considérée comme un Requiem pour le Troisième Reich ; j’ai ajouté que, selon mes prévisions, aucun compositeur du défunt régime soviétique ne composerait une œuvre équivalente. J’avais raison. De même qu’aucun écrivain de ce régime n’a écrit un roman comparable à Dieu est né en exil [5] de l’ancien fasciste roumain Vintilă Horia [*], sans parler de certains romans d’auteurs français qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient activement collaboré avec l’occupant et prôné un fascisme radical. À quoi est due cette différence dans la disparition des deux régimes ?
La transformation précipitée par l’effondrement de la gauche sociale et économique a été d’autant plus dévastatrice que la gauche a transformé la classe des travailleurs en une identité. La problématique de l’identitarisme a de multiples facettes, que j’aborderai successivement au cours de cet essai, mais je souhaite maintenant me concentrer sur son aspect désintégrateur.
Dans la perspective identitaire, le capitalisme en vient à être considéré comme une simple insulte, un nom attribué à tout ce que l’on déteste, et non un réseau de rapports sociaux mobilisés sur la base des rapports de travail et comme un système d’exploitation. Le problème de l’exploitation a pratiquement disparu, remplacé par l’inégalité dans la distribution des revenus, quand ce n’est pas l’économie même qui est mise de côté. La transformation de la classe ouvrière en une identité a été le coup mortel qui a liquidé l’extrême gauche sociale et économique, elle a été notre épitaphe.
Les exploités se définissent dans un système contradictoire de rapports entre des classes interdépendantes, de sorte que leur lutte pour l’abolition de l’exploitation, c’est-à-dire pour la suppression de ce système contradictoire, implique une lutte pour leur propre disparition en tant que classe sociale, avec les autres classes.
L’identitarisme, cependant, ne conçoit pas des exploités, mais des victimes, dont le caractère est indépendant des identités restantes. Cette hégémonie acquise par la notion d’oppression des victimes sur la notion d’exploitation des travailleurs correspond à un triomphe de l’anarchisme sur le marxisme, mais un anarchisme dans son mode le plus primitif et individualiste. La notion même de société s’éteint ainsi, ou du moins elle passe au second plan – comme nous l’avons bien vu, et tragiquement, lors de la récente pandémie [6] .
Comment une transformation aussi complète a-t-elle pu se produire ? Certes, on peut toujours utiliser une formulation économique abstraite pour définir l’exploité comme un individu occupant une position donnée dans un système donné de rapports de travail, quelle que soit son apparence empirique. Mais à l’aube du capitalisme, et pendant assez longtemps, la notion de classe exploitée correspondait à une réalité concrète et bien visible. Or, le développement économique a multiplié les instances constitutives du capitalisme et leurs articulations réciproques, en même temps qu’il l’a mondialisé, et ce double processus a accentué l’hétérogénéité sociale des travailleurs.
D’une part, l’accroissement de la complexité du travail, qui implique l’acquisition de nouvelles qualifications, non seulement ne concerne qu’une partie des travailleurs, mais il présuppose aussi que les qualifications antérieures soient reléguées à un statut inférieur, voire perdent leur utilité. Ce clivage a des effets tragiques aujourd’hui, quand on voit certains pays de l’Union européenne accueillir des immigrés professionnellement qualifiés et laisser les autres se noyer dans la Méditerranée.
Il ne s’agit pas seulement d’une différence de salaire entre les travailleurs les plus qualifiés et les moins qualifiés. L’aspect décisif est peut-être la différence croissante entre les niveaux d’éducation, les goûts et les comportements : comme le progrès économique aggrave toujours cette disparité, une véritable fracture sociale s’est créée entre les travailleurs les plus qualifiés et les moins qualifiés. La notion de classe moyenne est apparue dans ce fossé et s’est imposée ; ce concept a contribué à rendre encore plus difficile le fait que la classe ouvrière abstraitement définie en termes économiques se transforme en une réalité sociologique homogène. Et comme, entre-temps, le capitalisme s’est développé dans le monde entier, la classe ouvrière a intégré des cultures, des modes de vie, des religions et des processus de pensée distincts qui ont à peine commencé à créer des éléments communs.
La gauche marxiste, ou ce qu’il en reste, qui consacre tellement de temps et de pages aux contradictions entre les capitalistes et les travailleurs, ignore candidement les contradictions au sein de la classe ouvrière et saute de la définition économique de la classe à sa définition sociologique, comme si ce n’était pas la question cruciale. Pourtant, seule une mobilisation dans le cadre d’une lutte mondiale permettrait de colmater la disparité entre l’existence économique de la classe ouvrière et son inexistence sociologique actuelle en tant que classe.
Mais c’est bien là le problème, car comment les travailleurs pourraient-ils engager une lutte globale si, sociologiquement, ils sentent qu’ils n’ont rien ou presque en commun ? En plus de la concurrence habituelle sur le marché du travail, les travailleurs sont désormais séparés par d’énormes différences de qualifications et, peut-être pire encore, par la diversité des traditions culturelles, des religions et des habitudes de pensée. La solution possible apparaît ainsi comme la véritable difficulté. La distance croissante entre la définition économique de la classe ouvrière et son indéfinition sociologique permet au capitalisme de surmonter les obstacles à son développement en récupérant et en assimilant les conflits ponctuels et en les utilisant comme élément moteur de la complexité du travail et donc du raffinement de l’exploitation. La dilution de l’existence sociologique de la classe ouvrière réprésent un fait d’une importance capitale et la somme des identités s’est substituée à la classe ouvrière dans ce cadre, conduisant à l’extinction de la notion même de société.
Mais les conséquences sont encore plus graves.

Je pense avoir démontré de manière exhaustive [7] que le fascisme ne relève pas de l’extrême droite (ce que pense généralement la gauche) ni de la gauche, comme le prétendent certains partisans de la droite et, dans le cas du péronisme, comme le prétend une grande partie de la gauche elle-même. Le fascisme est une double chambre d’écho, où certains thèmes venant de la gauche se font entendre à droite et où d’autres thèmes venant de la droite résonnent à gauche. Ce croisement engendre un phénomène différent, dans lequel on peut trouver des traces de provenance, mais cela crée une nouvelle réalité idéologique et politique. C’est ce qu’a été le fascisme classique, né après la défaite de la grande vague de luttes que la classe ouvrière avait entamée pendant la Première Guerre mondiale et qui s’est poursuivie au cours des années suivantes.
Le fascisme n’a pas surgi pour vaincre un mouvement animé par la classe ouvrière, mais seulement après que ce mouvement eut été affaibli par ses contradictions internes et eut dégénéré à cause de sa bureaucratisation. Après avoir été militairement écrasé durant la Seconde Guerre mondiale, ce fascisme classique a survécu idéologiquement sous d’autres noms, sans montrer son visage ni assumer de nouvelles physionomies, jusqu’à ce qu’il réapparaisse au cours des dernières décennies sous des formes qui actualisent et renouvellent ses modalités classiques. Aujourd’hui, il se dresse également contre une classe ouvrière qui, pire que vaincue, se trouve désintégrée par l’absence d’une réalité sociologique qui corresponde à sa réalité économique. Les fascistes du post-fascisme ont fait irruption dans ce vide et s’y sont implantés.
Quatre caractéristiques suffisent à dessiner le visage du nouveau fascisme, que j’aborderai successivement au cours de cet essai. Il est plus facile de commencer par l’écologie, parce que la ligne de continuité avec le fascisme classique y est restée très visible. Dans les identitarismes, en revanche, l’affiliation est dissimulée, comme dans le cas de ces rivières qui coulent sous terre pour s’écouler plus loin. D’autre part, la reformulation du nationalisme dans le tiers-mondisme et dans ses incarnations actuelles, où il a été entièrement assimilé par les identitaires, a conservé divers aspects de l’époque classique du fascisme, au point que la terminologie et le discours semblent parfois avoir été copiés. Enfin, la création de mythes, sans lesquels le fascisme n’existe pas, ou qui fixent jusqu’au but ultime de son existence, a pris une ampleur considérable en se confondant avec le langage lui-même.
Ces quatre caractéristiques décrivent le monde dans lequel nous vivons, comme j’essaierai de le résumer dans la conclusion de cet essai.
Si, durant l’entre-deux-guerres, malgré tant de difficultés, la gauche et l’extrême gauche s’opposaient au fascisme, aujourd’hui, en dehors du fascisme postfasciste et de quelques continuateurs du fascisme classique, il n’existe que des régimes autoritaires et un conservatisme modéré, plus enclin au consensus et à la conciliation qu’aux conflits violents. Les fascistes du post-fascisme ont réapparu dans le camp de la gauche et l’ont absorbé. Le populisme est le croisement des échos des deux extrêmes, mais les aspirations de l’extrême droite se reflètent aujourd’hui surtout dans le camp de la gauche. Nous vivons dans une situation bien pire qu’il y a un siècle.
2
Si le capitalisme avait dompté le feu et inventé la roue, les partisans du mouvement écologiste voudraient nous laisser dans le noir et nous obliger à nous déplacer seulement à pied.
L’écologie a été formulée pour la première fois par Ernst Haeckel [*], un savant renommé qui, à la fin de sa vie, participa activement à la gestation des embryons du fascisme allemand. Le lien direct entre l’écologie, plus particulièrement l’agroécologie, et le fascisme ne peut être mis en doute par quiconque lit les ouvrages des idéologues fascistes et des livres historiques sérieux sur cette période. Il est significatif que tous ceux qui attaquent ma critique de l’écologie – et ils sont nombreux – restent silencieux sur les abondantes références bibliographiques que j’indique. En effet, il est plus facile d’avoir des convictions que d’argumenter avec des faits.
Si les régimes fascistes ont cherché à stimuler l’industrialisation et à accélérer la modernisation de l’économie, ils se sont également efforcés de maintenir des sociétés rurales archaïques et ont promu le mythe d’une paysannerie primitive, saine et immunisée contre les contradictions de la modernité. Le ruralisme a marqué d’une empreinte indélébile tous les fascismes sans exception. Je me limiterai ici à souligner les cas italien, portugais et japonais, et l’exemple notoire de la Roumanie, notamment dans la Légion de l’archange Saint-Michel [*] et sa Garde de fer [*]. Parfois, certaines pages écrites par Codreanu [*] me rappellent les apologies de Mao Zedong sur les paysans de Chine. Ce lyrisme politique ruraliste est apparu très tôt chez les Wandervögel [*], qui, pendant les premières décennies du XXe siècle, mobilisèrent la jeunesse scolarisée allemande pour rejeter la société urbaine et faire l’éloge de la vie à la campagne et de la rudesse des montagnes. Les Wandervögel constituèrent l’un des terreaux les plus fertiles pour la montée du nazisme, et la notion de l’univers en tant qu’organisme germa parmi eux ; cela eut deux conséquences idéologiques immédiates, le vitalisme et le spiritualisme néopaïen, qui marqueront plus tard profondément le Troisième Reich, où le lien entre écologie et fascisme est aisément perceptible.
L’agriculture biodynamique, inventée par Rudolf Steiner [*] en 1924 dans le milieu spiritualiste et théosophique de l’anthroposophie [*], a été adoptée en 1933 comme doctrine officielle du Troisième Reich par Walther Darré [8] [*] , ministre du Ravitaillement et de l’Agriculture, qui, par tactique politique, l’a appelée l’agriculture biologique. Mais le réseau de relations était bien plus vaste. Non seulement Hitler et Göring, les deux principaux personnages de l’État, étaient des écologistes zélés, mais Heinrich Himmler, agronome et membre du Conseil des agriculteurs du Reich, exprima son hostilité contre l’industrie alimentaire et mobilisa la SS, dont il était le chef suprême, et sa puissante machine politique, militaire et économique pour défendre l’écologie.
Blut und Boden, le sang et le sol, l’une des devises centrales du nazisme, fusionnait en une seule notion le racisme (le sang) et l’écologie (le sol). Comme toujours dans le Troisième Reich, il ne s’agissait pas d’une conviction matérialiste mais spirituelle, et l’écologie est inséparable du mouvement des Gottgläubige [*], les Croyants en Dieu, que les historiens appellent généralement les néopaïens, pour qui la race et le sol faisaient l’objet d’un culte anti-chrétien. Les nationaux-socialistes considéraient que les peuples nordiques, surtout germaniques, étaient dotés d’un sang supérieur, parce qu’ils étaient unis au sol par un lien spirituel d’un caractère particulier, qui les conduisait à respecter la nature et à préserver son équilibre, tandis que le Juif errant était le symbole d’une «antirace» composée de nomades sans racines, aussi destructeurs de la nature que de la société. Ce n’est pas moi qui le dis, ni le fruit de ma propre déduction.
Hitler, Himmler et d’autres dignitaires tenaient exactement ce discours et il s’agissait d’un lieu commun sous le Troisième Reich ; il suffit de lire les références bibliographiques que j’indique, raison pour laquelle mes contradicteurs ne les lisent pas. Il est donc compréhensible que le mouvement écologiste actuel soit étroitement lié aux identitarismes qui, comme j’aurai l’occasion de le montrer, reproduisent les aspects caractéristiques du racisme national-socialiste, et ce n’est pas un hasard si la réapparition de l’écologie s’est accompagnée de la mystique néopaïenne du New Age.
Sous le Troisième Reich, il ne s’agissait pas seulement d’idées, mais aussi de leur mise en œuvre. L’écologie, et plus particulièrement l’agroécologie, se confondait inextricablement avec le racisme national-socialiste dans ses aspects les plus destructeurs. Le même SS-Obergruppenführer qui supervisait l’administration économique des camps de concentration utilisait l’agriculture biologique pour cultiver les terres qu’il possédait. Et l’un des principaux anthroposophes spécialisés dans l’agriculture biodynamique, baptisée entre-temps biologique, fut chargé de diriger la ferme expérimentale que Himmler avait fondée à côté du tragique et célèbre camp de concentration de Dachau. Les SS y créèrent la plus grande et la plus fructueuse entreprise d’agriculture biologique de tout le Reich, l’Institut allemand de recherche nutritionnelle et alimentaire, où les prisonniers étaient utilisés comme esclaves pour cultiver des plantes pseudo-médicinales. Il ne s’agissait pas de cas particuliers, mais d’une règle générale, et lorsque Himmler publia un décret en décembre 1942 sur la manière dont le sol devait être traité dans les territoires slaves conquis à l’Est, il prescrivit spécifiquement le respect de l’équilibre de toute la nature et l’application d’une agriculture durable. Les partisans du mouvement écologiste n’étudient pas l’histoire par paresse, mais aussi par commodité ; s’ils ne l’ignoraient pas, ils devraient reconnaître que l’agroécologie se situe dans la filiation des idées et de la politique du Troisième Reich. Aujourd’hui, on se souvient des persécutions et des massacres commis par les nazis durant la guerre contre l’Union soviétique, mais il serait intéressant aussi que les écologistes se souviennent que la propagande nazie vantait le lyrisme de la nature et le paradis de la durabilité.
Curieusement, en politique, la perversité des uns et les erreurs des autres se conjuguent : en effet, l’effort qui a conduit les fascistes, après la Seconde Guerre mondiale, à dissimuler leur malignité a été favorisé par la censure que les Alliés victorieux ont exercée sur la littérature et l’art fascistes. Les premiers souhaitaient se faire oublier et les seconds voulaient qu’on ne se souvienne plus des fascistes, mais l’histoire sert à se souvenir des événements et non à les ignorer. Après 1945, les autorités d’occupation confisquèrent et détruisirent les manuels scolaires, y compris ceux qui diffusaient les théories nationales-socialistes sur l’écologie, interrompant ainsi une mémoire que personne ne semble vouloir raviver aujourd’hui. Certes, l’agriculture biologique [9] a continué à être prônée par quelques survivants du nazisme, comme l’ancien ministre de l’Approvisionnement et de l’Agriculture, et à être appliquée en Grande-Bretagne grâce à quelques excentriques de la noblesse rurale, mais elle n’a vraiment refait surface que dans les années 1970, en même temps que se dissolvaient les espoirs suscités par les luttes autonomes et étudiantes de la décennie précédente. Au lieu de créer quelque chose de nouveau, la contre-culture a ressuscité le passé, en promouvant l’écologie, accompagnée d’un néopaganisme déguisé en New Age.

Le fascisme apparaît toujours comme un croisement entre l’extrême gauche et l’extrême droite, dans lequel certains thèmes venant d’un côté résonnent dans l’autre, et vice versa. Ainsi, ceux qui prétendent aujourd’hui situer à gauche le mouvement écologiste, ou une partie de celui-ci, montrent seulement que cette forme actuelle de fascisme émane de la gauche, mais qu’un mouvement issu de l’extrême droite lui a donné son empreinte originelle. Le fait que l’écologie soit aujourd’hui hégémonique à gauche ne nous indique rien sur l’écologie, mais confirme tout sur le fascisme. Au lieu d’offrir une solution, l’écologie représente le problème.
Cependant, ma critique de l’écologie [10] en tant que composante du fascisme postfasciste ne se limite pas à sa filiation historique ; j’ai surtout insisté sur son archaïsme technologique et tenté de montrer ses conséquences économiques désastreuses. J’ai cité des faits concrets et des données empiriques, parce que les déductions fondées sur des spéculations philosophiques ne m’intéressent pas. Une théorie est un outil, et lorsqu’elle ne sert pas à analyser la réalité ou s’avère partiellement inadéquate, on la jette ou on la remodèle. Comme la réalité change constamment, les théories doivent toujours être remplacées ou adaptées.
En 2013, j’ai publié sur le site Passa Palavra un essai intitulé Contre l’écologie [11] . Toute personne intéressée pourra connaître en détail les données économiques qui m’ont amené à remettre en question l’écologie et l’agriculture biologique. Aujourd’hui, je me contenterai de prolonger les conclusions de ce texte pour les relier à la genèse fasciste de l’agroécologie. Je crois que la quatrième partie, «Agroécologie et plus-value absolue [12] », vous intéressera particulièrement.
Tout d’abord, l’agroécologie utilise des techniques obsolètes qui conduisent nécessairement à une faible productivité, calculée en fonction du nombre de travailleurs et du temps de travail, et qui pousse à l’augmentation des prix des produits. En concurrence avec les denrées alimentaires moins chères produites par l’agro-industrie selon des formes de culture modernes, l’agroécologie ne peut survivre qu’en orientant sa production vers le haut de gamme, où les prix sont plus élevés. Comme les produits de l’agroécologie ont un moins bon aspect, généralement un moins bon goût et se détériorent plus facilement, leur inclusion dans la gamme de luxe résulte d’une combinaison entre deux types d’opérations. D’une part, une propagande insidieuse prétend que les aliments issus de l’agriculture industrialisée sont nocifs pour la santé. D’autre part, l’appel à des convictions politiques ou mystiques, ou les deux à la fois, tente de nous persuader que l’achat de produits issus de l’agriculture biologique serait un acte politiquement correct. Dans l’histoire du capitalisme, seuls les régimes fascistes ont recours, de façon similaire, à des valeurs idéologiques contre le pragmatisme économique.
Deuxièmement, la faible productivité de l’agroécologie et l’archaïsme des techniques utilisées la placent dans un cadre d’exploitation qui, dans la terminologie marxiste, s’appelle la plus-value absolue [13] . La faible productivité par travailleur et par heure de travail signifie que ce type d’agriculture a besoin de plus de main-d’œuvre et que, pour être compétitive sur le marché, cette main-d’œuvre travaille plus longtemps. Cette haute intensité en main-d’œuvre, et non en capital comme dans l’agriculture industrialisée, rend l’agriculture biologique plus adaptée aux unités de production familiales, où le temps de travail n’est pas clairement comptabilisé et où le recours au travail des enfants est courant. Dans ce domaine, l’agroécologie reproduit aussi ses précédents dans le fascisme, notamment sous le Troisième Reich, où le ministère du Ravitaillement et de l’Agriculture, tout en promouvant l’agriculture biologique, renforçait le cadre familial de la petite propriété agricole dans un système d’héritage inaliénable qui se développa dans le Reich lui-même, mais présida aussi à la colonisation des territoires conquis à l’Est. L’écologie, à travers l’agriculture familiale, se mêla aux aspects raciaux les plus agressifs du nazisme.
Enfin, la faible productivité de l’agriculture biologique, avec la baisse conséquente du volume de production, la rend incapable de subvenir aux besoins de la population mondiale. Il suffit de regarder les statistiques et de comparer la croissance de la population et les étendues de terres arables disponibles avec les limites imposées à la productivité par l’agriculture biologique. Le mot génocide, s’il est utilisé correctement, ne s’applique qu’à une culture ou à un groupe ethnique, mais dans ce cas, un massacre de plusieurs millions de personnes se produirait, quelle que soit la qualité des victimes.
Il nous faut à nouveau invoquer le précédent du Troisième Reich, ce méta-capitalisme que les nazis prétendirent instaurer et dans lequel la productivité économique était un critère délibérément mis de côté tandis que, pour des impératifs idéologiques, la main-d’œuvre qualifiée était massacrée, dans le Reich comme dans les territoires conquis à l’Est, tandis que les industries de ces territoires étaient également détruites. Là encore, le fil de la mémoire a été coupé, mais même lorsqu’il ne l’est pas, comme dans le cas des Khmers rouges ou plus récemment du Sri Lanka, l’oubli se produit de façon automatique. La répulsion pour les données empiriques est indispensable à toute foi, et rien ne s’y oppose plus que la mémoire des faits.
Les fascistes prétendaient être anticapitalistes, mais ils prônaient en réalité un méta-capitalisme dans lequel l’idéologie prévalait sur l’économie, avec ce mélange de modernisme et de primitivisme qui caractérisa tous les fascismes. Lors de la récente pandémie, nous avons eu un exemple tragique de ce primitivisme, et du mépris de la vie humaine qu’il implique, lorsque des militants d’extrême gauche et d’extrême droite se sont rejoints [14] et confondus dans les rues pour protester contre les vaccins et ce qu’ils appelaient une dictature sanitaire. Cette convergence de pratiques et de thèmes a puissamment contribué à la gestation du fascisme actuel, et ce n’est pas un hasard si de nombreux agro-écologistes, défenseurs des médecines traditionnelles, ont participé à ces manifestations. Le fascisme ne naît pas d’un coup, ses caractéristiques ne sont pas immuables, mais il est engendré de façon répétée, lorsque les circonstances historiques conduisent au croisement des extrêmes.
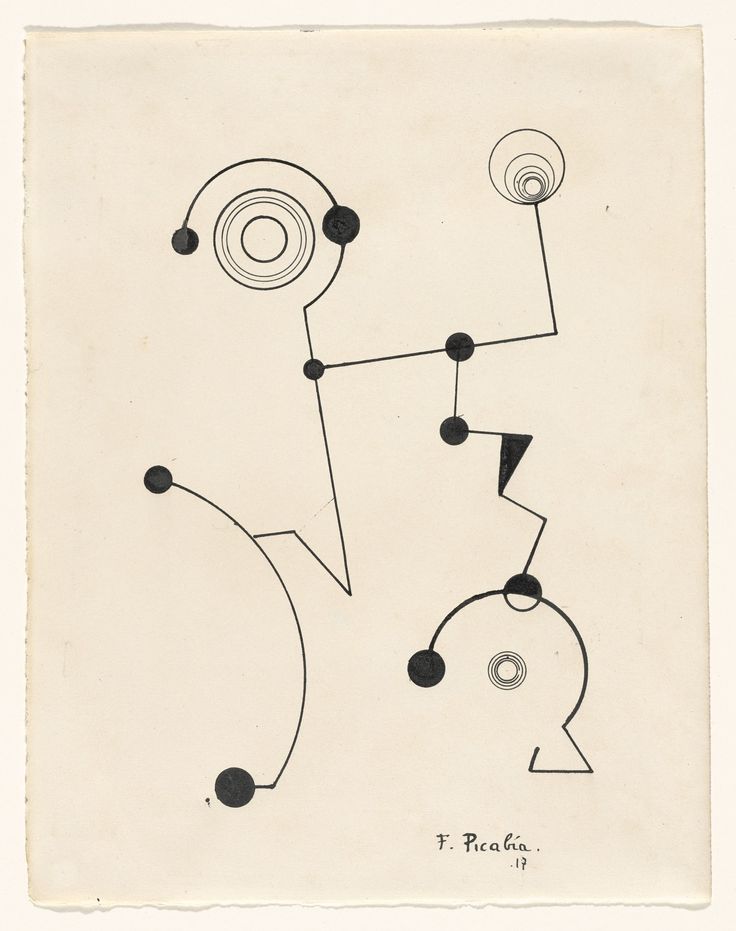
Dans ce panorama, où devons-nous placer les marxistes ou, plus exactement, ceux qui font partie des multiples chapelles qui se réclament aujourd’hui du marxisme ? Ils ne lisent ni les auteurs fascistes, ni les ouvrages empiriquement sérieux sur le fascisme ; ils réfèrent lire Marx, qui a écrit avant que le fascisme n’apparaisse. Comme on peut s’y attendre, ils ne savent rien. Même Engels, lorsqu’il a écrit sur Dühring [*] * et le général Boulanger, deux personnages qui anticipèrent ce que deviendrait le fascisme, n’a eu aucune intuition sur un phénomène politique qui émergeait à peine à l’époque. Nous ne devons pas le lui reprocher, car rares sont ceux qui sont capables d’interpréter les présages. Mais il nous faut blâmer ceux qui se limitent à certains auteurs pour enquêter sur des questions que ces mêmes auteurs n’ont pas abordées.
Il est encore plus curieux, voire hilarant, de voir des marxistes invoquer Marx pour défendre le mouvement écologiste, alors que Marx et Engels firent l’apologie du progrès apporté par les techniques et en comprenaient l’irréversibilité. Pour les deux fondateurs du marxisme, le capitalisme avait atteint un degré supérieur dans l’émancipation technologique et sociale de l’humanité, ce qui permettrait d’aller plus loin et de créer une société libérée des besoins matériels. De plus, ils considéraient que la croissance des forces productives dépasserait, à un moment donné, les cadres juridiques du capitalisme et précipiterait l’avènement du socialisme.
En réalité, cette croissance a imposé une intervention économique active de l’État, tant sous la forme des capitalismes d’État que sous la forme de systèmes mixtes dans lesquels la propriété de l’État coexiste avec des entreprises privées. Des formes collectives d’appropriation se sont parfois développées, mais elles n’ont concerné qu’une seule classe capitaliste, la classe des gestionnaires [*]. La croissance des forces productives n’a cependant pas modifié le caractère fondamental du capitalisme, qui découle des rapports sociaux de travail, fondés sur l’exploitation de la plus-value. Nous sommes là devant l’une des ambiguïtés cruciales du marxisme puisqu’il admet que le lien entre les forces productives et les rapports de propriété implique quelque chose qui peut seulement être réalisé – si tant est qu’il le soit – au niveau des rapports sociaux, par le biais de la lutte des travailleurs.
Si pour Marx et Engels le capitalisme est un stade historique destiné à être dépassé et les forces productives qu’il développe sont la condition pour atteindre le socialisme, considéré comme l’émancipation des contraintes matérielles, la crise de la gauche a transformé le marxisme en son contraire – elle a converti l’émancipation technologique en une catastrophe technologique, comprise comme un conflit de la société contre la nature ; et elle a remplacé le projet de dépassement du capitalisme par la volonté d’éliminer et d’effacer toutes les traces techniques du capitalisme.
En bref, la transformation interne de la société à travers la lutte de classe au niveau économique a été remplacée par l’effondrement externe du capitalisme, prophétisé par le mouvement écologiste, ce qui explique le désintérêt que la plupart des marxistes manifestent aujourd’hui pour l’analyse économique. La critique sociale du marxisme a ainsi cédé la place à une apologie mystique de la nature. A la révolution sociale s’est substitué l’apocalypse. La dialectique marxiste est devenue une forme laïque du dualisme religieux, le Bien contre le Mal.
De plus, la notion de nature proposée par le mouvement écologiste est mystique : la nature n’existe pas indépendamment de notre action. Depuis que les premières communautés humaines se sont formées, elles ont inventé des techniques pour se protéger d’une nature destructrice, et la survie de la société a été assurée par cette maîtrise technique de la nature. Les populations les plus primitives chassaient beaucoup, et, avant que les hommes ne découvrent des moyens de conserver les aliments, ils commirent d’énormes gaspillages et sans doute des ravages très importants parmi les animaux. En règle générale, plus les techniques étaient primitives, plus elles étaient destructrices, proportionnellement aux bénéfices obtenus.
Plus tard, l’action de l’humanité sur la nature a laissé des traces encore plus profondes et définitives : dès le début du néolithique, la domestication des plantes et des animaux entraîna des modifications génétiques qui se transmirent bien au-delà de l’intervention humaine. Aujourd’hui, au sommet de la plus haute montagne, ou au cœur de la forêt la plus dense et la plus lointaine, la nature a été modifiée par l’humanité durant plusieurs millénaires. La nature naturelle n’existe pas, sauf dans les délires mystiques du mouvement écologiste. Et lorsque les sociétés perçoivent l’existence d’un déséquilibre entre les techniques, ou dans la relation des techniques avec la nature, elles le corrigent en utilisant de nouvelles techniques, en créant éventuellement d’autres déséquilibres, qui seront à leur tour corrigés. Il n’existe donc pas d’équilibre naturel, et ce que nous appelons déséquilibre est, en fait, la dynamique de l’évolution des sociétés.
Depuis le Club de Rome [*], sinon avant, les écologistes recourent systématiquement à l’artifice démagogique qui consiste à présenter des projections comme s’il s’agissait de prévisions. Or, la différence entre ces deux méthodes réside précisément dans la créativité humaine. Néanmoins, même si les projections des écologistes n’ont jamais été vérifiées, ils continuent imperturbablement à annoncer l’imminence de la catastrophe.
Ce que Marx et Engels ont écrit sur les forces productives matérielles est très pertinent tant que nous nous limitons à elles. Plus pertinente encore, comme toujours, est l’étude empirique de l’histoire, qui nous montre une succession de techniques nées au sein d’un ensemble technologique, puis assimilées par d’autres ensembles technologiques, sans pour autant rester liées aux technologies d’origine. Une technologie est une structure qui dicte la position et la fonction des éléments techniques qui la composent, tout comme les mots dans une langue, par exemple. Et de même qu’un mot peut changer de langue et acquérir dans la nouvelle structure linguistique un autre sens, une autre valeur et même changer de forme, de même une technique peut être insérée dans une technologie différente de celle dans laquelle elle a été engendrée et obtenir de nouvelles caractéristiques, dictées par la structure technologique dans laquelle elle s’est intégrée.
La domestication du feu nous offre un exemple classique. Le feu a eu un impact énorme sur la vie matérielle de tous les peuples qui ont appris à le domestiquer et à le conserver, puis à le produire. Les conséquences de cette technique sur la vie matérielle étaient inséparables de la vie spirituelle, car les gardiens du feu étaient des prêtres, chargés d’entretenir la flamme ; et les principaux dieux étaient les seigneurs du feu, de la foudre et du tonnerre, avec leur capacité à la fois destructrice et bénéfique. Bien des millénaires plus tard, dans les civilisations urbaines déjà très développées, le feu reste un élément central de différents cultes : aujourd’hui encore, dans le catholicisme, que sont les bougies si ce n’est une pâle réminiscence du caractère sacré des flammes? Je vois souvent à l’entrée des églises des bougies électriques que l’on peut allumer en introduisant une pièce de monnaie. Ce parcours accidenté, presque aussi long que l’histoire de l’humanité, illustre la relation entre la technologie et la technique. Le feu n’a jamais cessé d’être indispensable, même s’il a cessé d’occuper une place centrale au sein de la vie spirituelle pour être ensuite sécularisé, et s’il est devenu un élément technique adopté par toutes les technologies. La roue nous offre un autre exemple, une technique, que seules de rares technologies n’ont pas utilisée. En effet, quelles sont les techniques importantes qui échappent à cette réflexion ?
Mais les adeptes des mouvements écologistes qui prétendent critiquer la société actuelle, et parmi eux les éco-marxistes, imaginent que les techniques engendrées dans la technologie capitaliste portent inévitablement les caractéristiques du capitalisme. Ils ont cessé de considérer le capitalisme comme un système de rapports sociaux de travail et l’ont progressivement réduit à une technologie, comprise non comme une structure mais comme un bloc maléfique. Pour eux, la liquidation du capitalisme se limite à l’élimination d’une technologie.

Si le capitalisme avait dompté le feu et inventé la roue, les tenants de l’écologie voudraient nous laisser dans l’obscurité et nous obliger à marcher à pied. Ils font l’apologie des sociétés archaïques et du ruralisme primitif sur cette base. Ils ne comprennent pas que, si une rupture sociale majeure conduit à la création d’une nouvelle technologie, les techniques originellement capitalistes peuvent être insérées dans la nouvelle structure, où elles acquerront d’autres connotations. Durant la vague de luttes autonomes des années 1960 et 1970, les occupations d’entreprises ont, dans plusieurs cas, esquissé l’intégration des techniques existantes dans un possible remodelage de la technologie au service d’une libération des travailleurs. Les techniques du capitalisme d’abondance peuvent être assimilées par la technologie d’un éventuel socialisme d’abondance, mais les écologistes visent à établir une société de pénurie.
Réponse de João Bernardo à un lecteur
Cher Paulo, te remercie pour ton commentaire qui me permet de clarifier une question centrale.
Je ne critique pas l’écologie en tant que science puisque je ne critique pas les sciences. Ma critique vise les mouvements écologistes qui considèrent que l’ensemble de la société industrielle détruit la nature, alors qu’au contraire, la technologie développée par la société industrielle est la première qui permette a) de détecter et b) d’éviter les effets néfastes exercés par les groupes humains sur la nature. Au cours de l’histoire, plus les techniques étaient rudimentaires, plus les destructions étaient importantes, proportionnellement à la taille des groupes humains qui les utilisaient et au volume des bénéfices obtenus. Maîtriser la nature, en tirer le meilleur parti et en même temps la préserver, ces trois objectifs ne pouvaient être formulés ensemble que dans la société industrielle.
J’ai souvent abordé cette question, mais je vais maintenant donner un seul exemple tiré d’une période que j’ai étudiée en détail, le régime seigneurial européen. Dans Poder e Dinheiro [15] , j’ai observé à propos du bois : «Cette matière première occupait la place cruciale, et il n’y a certainement pas eu d’autre système technologique aussi entièrement dépendant d’un seul matériau» (volume I, p. 322).
L’utilisation intensive du charbon au début de la société industrielle a été la conséquence de la destruction des bois pendant le régime seigneurial, en raison d’une technologie centrée sur l’utilisation du bois. L’étude des sociétés préindustrielles peut se résumer à l’étude de la destruction massive de la nature végétale et animale. Seule la société industrielle a réussi à augmenter la productivité sans provoquer de telles destructions. Tel est le cœur de ma critique des mouvements écologistes.
Tu cites des exemples soviétiques de préservation de l’environnement, précisément dans un régime qui promouvait une industrialisation accélérée et massive. Mais tu ne trouveras pas dans le régime soviétique l’apologie de techniques ou de mythologies précapitalistes, comme dans l’agriculture biologique.
Il est curieux que tu cites Trotski à ce sujet, et je te renvoie à un passage des Labirintos do fascismo, où j’ai écrit : «Pourquoi le paysage, délibérément représenté comme tel, n’est-il apparu qu’à l’époque baroque, lorsque l’urbanisation consciente et planifiée s’est généralisée ? Jusque-là limité à la décoration des récits, qui étaient le sujet principal des toiles, le paysage s’est émancipé à l’époque baroque ; et même si l’histoire ou l’épisode étaient encore présents, ils n’étaient plus qu’un prétexte. Le paysage est la campagne vue à travers les yeux des citadins. Dans son autobiographie, Trotski écrit : “J’étais né et avais été élevé à la campagne, mais c’est à Paris que je me rapprochai de la nature. C’est là aussi que je me trouvai mis en présence de l’art véritable.” L’association d’idées est éclairante. C’est l’art qui amène le citadin à regarder la nature. Le paysage n’est pas l’expression de l’hégémonie des valeurs rurales, mais leur nostalgie» (Hedra, 2022, vol. V, p. 96). Le paysage est une construction mentale du citadin, et les jardins sont l’expression de la domination que cette construction mentale exerce sur la nature, une véritable architecture humaine de la nature. Aujourd’hui, les mouvements écologistes veulent exactement le contraire.
Il n’y a pas d’antagonisme entre la société industrielle et la protection de la nature. Au contraire, l’une est une condition de l’autre.
3
La sexualisation et la racialisation de toutes les questions insèrent les identitarismes dans la logique raciale du Troisième Reich.
Les identitarismes ont introduit dans les conflits sociaux une innovation tactique, une formulation explicite et inédite, inspirée par la notion de la «place de la parole [*]». Le rôle qui était auparavant dévolu aux avant-gardes classées strictement en fonction de leur position politique est désormais légitimé par la couleur de peau ou d’autres caractéristiques physiques, la naissance dans telle ou telle communauté ethnique ou le fait de revendiquer tel ou tel sexe présumé ou déclaré. De plus, ces critères pouvant se croiser, le nombre d’identités tend à se multiplier sans limite. Ainsi définie, chaque identité se distingue des autres et établit sa propre hiérarchie de privilégiés et d’exclus – nous et les autres.
Il ne semble pas déraisonnable de classer l’identitarisme comme une forme de calvinisme laïque – et je dois dire que je considère le calvinisme comme la pire des abominations théologiques engendrées dans la sphère du christianisme.
D’une part, la doctrine de la grâce est transposée dans l’identitarisme à travers l’idée que l’on appartient à une identité en raison des caractéristiques involontaires héritées à la naissance, rétablissant (en termes profanes) la dichotomie entre les «élus» et ceux qui ne seront jamais sauvés. D’autre part, le puritanisme extrême et agressif du calvinisme refait surface dans le comportement des identitaires. Si cette analogie est pertinente – et j’insiste sur le si -, on comprend mieux pourquoi les identitarismes ont commencé à être formulés dans les pays anglo-saxons, inspirés par la tradition calviniste, et se sont répandus au Brésil en même temps que les Églises évangéliques. Mais, comme toujours en histoire, on ne pourra obtenir une explication correcte, ou du moins solide, qu’en élargissant l’éventail des comparaisons, et il faudrait étudier la chronologie et les canaux de diffusion de l’identitarisme dans d’autres pays. Mais même sans me livrer à ce travail, je relèverai la similitude entre le calvinisme et les identitarismes.
Cette sorte de religiosité laïque de l’identitarisme se manifeste également sous un autre aspect. Les marxistes avaient conçu la notion d’une classe exploitée, révolutionnaire parce qu’elle vivait au cœur des contradictions du capitalisme ; par conséquent, en éliminant l’exploitation, elle s’abolirait elle-même en tant que classe, en abolissant du même coup les autres classes sociales.
Les personnages de l’identitarisme, cependant, au lieu d’être exploités, sont des victimes. Dans une société comme celle des démocraties développées, bénéficiant d’un État-providence et de compagnies d’assurance, la victime n’a pas d’autre exigence que celle d’être indemnisée. Les exploités, pour cesser d’être exploités, doivent mettre fin à la société d’exploitation ; mais, pour que quelqu’un cesse d’être une victime, il lui suffit d’être indemnisé. Toutes les personnes qui se reconnaissent dans une identité, quelle qu’elle soit, se conçoivent comme des victimes et, à ce titre, accèdent à une «place de la parole», ce qui entraîne en soi le droit d’être indemnisé grâce à l’intégration dans l’élite. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle élite, comme cela s’est produit dans d’autres processus d’ascension sociale, par exemple dans les régimes soviétiques, mais de s’insérer dans l’élite existante et de la renouveler.
Tel est l’objectif de la politique des quotas, qui ne se limite pas aux universités et s’est étendue aux gouvernements et aux administrations des entreprises. Notons que la politique des quotas s’applique seulement aux professions prestigieuses, car personne ne réclame l’instauration de quotas dans les métiers pénibles et mal payés, où l’on constate pourtant des préférences et des déséquilibres qui affectent inévitablement l’une ou l’autre des identités existantes. De plus, lorsque les grands cabinets de conseil en entreprise ont découvert que l’intégration des identités ethniques et sexuelles dans les directions et chez les cadres augmentait la productivité [16] , le renouvellement des élites s’en est trouvé facilité.
Ainsi, si la multiplication des identitarismes aggrave la fragmentation des travailleurs et les affaiblit en tant que classe, leur absorption par les élites universitaires, politiques et économiques contribue à homogénéiser les classes dominantes, surtout la classe des gestionnaires. L’identitarisme est une soupape d’échappement aux effets sociaux stabilisateurs.
Le sexe, ou les préférences sexuelles, éventuellement assumées comme étant celles d’un autre sexe, ou la couleur de peau, ou d’autres caractéristiques physiques, ou n’importe quelle combinaison de ces critères ou même leur subdivision, tel est le tamis utilisé pour évaluer la pertinence avec laquelle quelqu’un peut justifier la «place de sa parole» et revendiquer ainsi le droit d’être intégré dans l’élite. L’inspiration biologique de ces paramètres donne inévitablement à l’identitarisme un caractère racial. Ce caractère se révèle d’autant plus prononcé que le membre d’une identité, défini comme victime, est l’héritier naturel de toute une lignée de victimes ; par conséquent, plus la lignée est longue, plus la victime actuelle sera légitimée à être qualifiée de martyr. Ainsi, le racisme des identitarismes ne se limite pas à une affirmation épisodique mais, comme tous les racismes véritables, il prétend hériter de traditions obtenues par simple naissance.
Il s’agit cependant d’un racisme différent de celui qui a prévalu dans les démocraties coloniales et dans la plupart des fascismes, auquel l’eugénisme donna un vernis scientifique illusoire. Ce racisme se contentait de postuler une hiérarchie des intelligences ; il affirmait l’infériorité intellectuelle des personnes ayant certaines caractéristiques physiques et la supériorité de celles ayant d’autres caractéristiques physiques, et admettait une gradation de situations intermédiaires.
Le racisme identitaire repose sur des postulats différents mais suit un schéma logique identique aux notions raciales qui accompagnèrent la montée en puissance du parti de Hitler et qui furent ensuite systématisées et appliquées par les SS. Le racisme nazi se distingue du racisme ordinaire par la nature triangulaire de ses composantes et la circularité de son cheminement causal. Les historiens actuels, sans parler des journalistes, ne comprennent pas la nature du Troisième Reich parce qu’ils opèrent une confusion entre ces deux modalités du racisme.

Tout d’abord, au lieu d’une simple hiérarchie qui inclurait, à une extrémité, une race supérieure et, à l’autre, une race inférieure, les nazis concevaient une triple relation entre la «race des seigneurs», les «sous-hommes» et «l’antirace». Cette conception impliquait une dialectique plus complexe que celle d’un ordonnancement linéaire. Tout d’abord, entre les «seigneurs» et les «sous-hommes», il n’y avait pas de situations intermédiaires, car les «sous-hommes» étaient littéralement infrahumains et tout produit d’une miscégénation [17] serait exclu de la véritable humanité.
Hitler et les autres autorités étaient clairs sur ce point : ils insistaient sur le fait que l’accouplement entre une personne de la race supérieure et une autre appartenant à la sous-humanité ne pourrait jamais promouvoir les sous-hommes et ne conduirait qu’à la dégradation raciale des individus supérieurs.
D’autre part, «l’antirace» ne se distinguait pas de la «race des seigneurs» parce qu’elle souffrait d’un quelconque déficit intellectuel, mais parce qu’elle était censée posséder une intelligence perverse, désintégratrice, incapable de procéder à des synthèses concrètes, tant sociales que mentales, alors que la «race des seigneurs» était censée ériger et maintenir les grandes constructions sociales, construisant la culture au lieu de la détruire. En simplifiant à l’extrême, la «race des seigneurs» devait dominer la sous-humanité, mais pour cela elle devait empêcher «l’antirace» de miner cet ordre stable.
Deuxièmement, le nazisme allemand a hérité d’une notion de circularité des enchaînements causaux formulée en détail par Houston Stewart Chamberlain, un Britannique qui obtint la nationalité allemande pendant la Première Guerre mondiale et s’intégra dans le courant dominant de la culture allemande. Comme il est d’usage dans tout racisme, Chamberlain partait du principe qu’une constitution donnée du corps engendrait une formation donnée de l’esprit : il reconnaissait une relation de cause à effet entre la biologie et l’idéologie. Mais il reconnaissait également une causalité inverse. «[…] ce que nous désignons par le mot “race” est, dans certaines limites, un phénomène plastique», écrit-il, «et de même que le physique réagit sur l’intellect, l’intellect réagit de la même manière sur le physique». Chamberlain présume donc qu’une idéologie donnée peut donner naissance à une biologie spirituelle, c’est-à-dire à une caractéristique physique qui, bien qu’elle soit invisible, n’en est pas moins réelle ; il va jusqu’à parler de «dolichocéphalie spirituelle». Dans cette inversion (du parcours de la) de causalité, un Allemand qui n’avait pas les traits physiques habituellement attribués à son peuple, mais qui s’immergerait dans la culture allemande, acquerrait effectivement ces traits, mais de manière spiritualisée. Dans le même temps, un autre Allemand, à l’apparence physique conventionnellement germanique, s’il fréquentait des cercles juifs et se laissait absorber par la culture juive, ne changerait pas ses traits visibles, mais sa biologie spirituelle deviendrait juive et il ferait partie de «l’antirace».
Hitler et les SS étaient donc opposés à toute définition strictement biologique du Juif. Un scientifique national-socialiste, Fritz Lenz, résume la question en affirmant que «nous pourrions en fait classer les Juifs comme une race spirituelle», et Hitler, déjà au bord du suicide, répéta à ses convives que «la race juive est avant tout une race mentale» et ajouta qu’»une race mentale est quelque chose de plus solide et de plus durable qu’une simple race».
L’historiographie actuelle du fascisme est victime d’un grand nombre de falsifications intéressées, venant de tous les côtés, mais dans le cas spécifique du nazisme, la falsification a des effets encore plus funestes. Dans la mesure où ils étaient considérés comme des éléments qui voulaient subvertir l’ordre, le Troisième Reich assimilait les marxistes, communistes et socialistes aux Juifs, tout comme les Juifs, issus de «l’antirace», étaient donc eux aussi des éléments subversifs. Le lieu approprié pour enfermer puis liquider «l’antirace» était les camps de concentration, où la prétendue circularité entre biologie et idéologie eut ses effets les plus tragiques, tout comme, pendant la guerre, les brigades mobiles d’extermination opérant dans les territoires conquis à l’Est confondirent souvent Juifs et marxistes dans la comptabilité du génocide. Comment les distinguer si, d’un côté ou de l’autre, ils appartenaient tous deux à «l’antirace» ?
Or, le racisme identitaire est similaire au racisme national-socialiste à ces deux égards.
Premièrement, parmi toutes les identités possibles, une seule remplit la fonction d’anti-identité – l’homme hétérosexuel, blanc, culturellement européen. D’une part, il s’agit d’une identité, parce qu’il serait difficile d’en trouver une autre qui manifesterait sa présence de manière plus palpable et plus enracinée. Mais d’autre part, nous avons affaire à une anti-identité, parce que son évocation ne sert qu’à affirmer davantage les identités qui s’y opposent. Cette anti-identité n’a aucun des aspects positifs attribués aux identités, pour lesquelles elle est censée assumer seulement une fonction destructrice. Les identitarismes prétendent se légitimer en luttant contre les discriminations, mais, dans la mesure où ils supposent toujours l’existence d’une anti-identité, ils développent de nouvelles formes d’intolérance et de discrimination.
Ces dernières années, j’ai rencontré dans les textes identitaires marxistes la séquence «capitalisme/colonialisme/hétéropatriarcat» : grâce à cette curieuse transposition des contradictions économico-sociales, l’anti-identité prend la place précédemment occupée par l’exploiteur. Quand un système d’idées comme le marxisme, né et enraciné dans une conception strictement sociale de l’économie, se laisse assimiler par la triple logique raciale adoptée par le nazisme, il ne peut y avoir de triomphe plus flagrant de l’identitarisme.
Deuxièmement, la circularité dans laquelle on passe de l’idéologie à la biologie avec la même dextérité que l’on passe de la biologie à l’idéologie constitue l’autre mécanisme constitutif de l’identitarisme. Par exemple, on donne à une personne noire la «place de la parole», parce qu’on lui reconnaît les idées qui, selon son mouvement identitaire, devraient lui correspondre biologiquement. Mais ce même mouvement noir considère qu’une personne noire vivant dans un environnement socio-économique et culturel généralement attribué aux Blancs devient blanche et ne doit donc pas bénéficier de la «place de la parole» ou de la politique des quotas. Lorsqu’il est affirmé dans une annonce officielle brésilien, selon une terminologie très courante, que «les quotas raciaux sont destinés aux pardos [*] negros [métis à la peau noire, d’origine africaine, NdT] et non aux pardos [métis à la peau plus «claire», combinant deux ou plusieurs origines, donc pas forcément afrodescendants, NdT] socialement blancs», ce passage direct du social au racial n’illustre-t-il pas la biologisation d’une culture ? La circularité entre le biologique et l’idéologique, et inversement, ne diffère en rien de celle qui caractérisait le racisme national-socialiste.
De manière encore plus évidente, un individu de sexe masculin qui adopte des idées et des comportements considérés comme féminins peut se dire «trans», c’est-à-dire acquérir idéologiquement une biologie féminine invisible, tout comme une situation symétrique se produit lorsqu’une personne de sexe féminin acquiert idéologiquement une biologie masculine invisible. La «dolichocéphalie spirituelle» inventée par Chamberlain et la «race mentale» évoquée par Hitler trouvent ici un terrain fertile. On peut procéder à des changements physiques accessoires et illusoires parce qu’ils n’abordent pas la question fondamentale. En effet, la mise en scène peut aller trop loin, notamment en cas d’utilisation de bloqueurs de puberté, avec des conséquences très néfastes pour la santé. Et pourquoi changer de sexe si l’on prône en même temps une sexualité non binaire ?
Mais les paradoxes ne gênent pas les identitaires, et il faut souligner maintenant que, «trans» ou pas, les femmes continuent à avoir certaines caractéristiques physiques indélébiles et les hommes, d’autres. Cette mise en scène ne fait qu’expliciter la biologie mentale dont parlait Chamberlain. Le prétendu clivage sexe/genre correspond à la circularité entre biologie et idéologie adoptée par le racisme du Troisième Reich.
Il me semble étrange, mais aussi paradoxal, que selon la doctrine actuelle la distinction entre sexe et genre s’applique exclusivement aux êtres humains, et non aux animaux, pour lesquels le genre correspond toujours au sexe [18] , alors que ce même milieu politique critique l’anthropocentrisme et insiste sur l’intégration de l’humanité dans la nature. Mais peut-être aurons-nous bientôt des animaux de compagnie «trans» ?

En conclusion, la sexualisation et la racialisation de toutes les questions insèrent les identitarismes dans la logique raciale du Troisième Reich [19] . Cela se produit lorsque l’on biologise le social et que l’on présente le corps comme le terrain du politique.
Se définissant par l’exclusion des autres, chaque identitarisme tend nécessairement à s’enfermer entre des barrières. Elle s’enferme doublement, d’une part en cherchant à interdire la critique et, d’autre part, en évitant tout ce qui choque sa sensibilité. Là où la gauche appelait à une société permissive et à l’acceptation des différences, aujourd’hui toute différence devient une identité protégée par la censure et les tabous. Cette expansion d’un stalinisme sans Staline m’amène à me demander si la gauche n’est pas condamnée à finir dans le stalinisme. Nous avons cherché la liberté et le libertinage, pour finalement aboutir à la multiplication du puritanisme. Et malheur à celui qui est accusé de violer les normes dictées par les identitaires de tout poil ; la présomption d’innocence est devenue une présomption de culpabilité, non seulement pour l’opinion publique, mais aussi pour les administrations et les tribunaux.
La censure est devenue beaucoup plus facile avec les réseaux sociaux, qui permettent d’exclure et de réduire au silence des personnes, voire même de favoriser le lynchage virtuel. Curieux paradoxe : né pour faciliter la diffusion des connaissances et la confrontation des opinions, Internet sert aujourd’hui à imposer des points de vue et à supprimer le débat. Dans le même temps, la politique de la «place de la parole» s’est développée dans la création d’espaces sécurisés (safe spaces), où les personnes s’affiliant à une identité donnée ne courent pas le risque de se sentir blessées par des rencontres avec des personnes d’autres identités ou, pire encore, anti-identitaires. En effet, la censure est devenue tellement omniprésente dans la société qu’elle a atteint le niveau personnel ; tout litige avec une personne qui s’assume comme appartenant à une identité, même lorsque cette identité n’est ni l’objet ni l’argument du litige, est présenté comme un crime de lèse-identité et conforte la personne dans le rôle de victime. Et de même que «la place de la parole» peut s’exercer virtuellement, des espaces sécurisés existent aussi dans le monde virtuel, et la fréquentation de certains sites ou de certains réseaux est interdite parce qu’ils sont considérés comme des espaces non sécurisés. Ainsi, la censure s’étend, empêchant la confrontation des idées, tout en augmentant le contrôle que les chefs de chaque groupe identitaire exercent sur leurs adeptes. L’idéal de l’identitarisme est la conversion de la société en un ensemble de tiroirs indépendants, unis par le seul marché.
Mais si l’on évite, voire si l’on punit, tout ce qui choque la sensibilité, au motif que cela met en péril une identité, alors l’art et même les ruptures scientifiques sont bloqués, car toute nouveauté provoque un malaise ou suscite l’inquiétude. Même dans le domaine de la physique, apparemment épargné par les vicissitudes de la politique, il suffit de penser à l’inconfort mental provoqué par les grandes découvertes scientifiques de la première moitié du XXe siècle. Même l’humour et l’ironie sont regardés avec beaucoup de méfiance. En effet, le rire serait-il une insulte ? Et l’ironie n’est-elle pas l’art de faire trembler sous nos pieds un sol que l’on croyait ferme ?
Ces dernières années, on m’a demandé à plusieurs reprises dans des interviews pourquoi je lisais des romans, comme si à gauche cela devait être un motif d’étonnement. J’ai répondu que la fiction, quand elle est vraiment fiction, consiste à déployer les contradictions internes de personnages qui ne sont jamais enfermés dans un milieu social ou idéologique restreint, et qui refusent ainsi les limites qui légitimeraient les identités. Je remarquais, à propos de la censure et des tabous, que la gauche ne semblait pas débarrassée du stalinisme, et je le constate à nouveau, parce que le stalinisme a promu une pseudo-fiction dans laquelle les personnages n’étaient que les emblèmes d’une doctrine. Sans questionner les identités ni choquer les sensibilités, toute la vie intellectuelle se résume à la fange des lieux communs.

A une époque où l’identitarisme commençait à peine à pénétrer les départements universitaires, un ami, professeur à l’Université publique de Campinas, me raconta qu’il n’était pas intéressé par une recherche dont l’auteure, avant de commencer, savait à quelle conclusion elle allait parvenir. Les recherches en sciences sociales obéissent désormais à cette règle, car malheur à celui qui arrive à un résultat qui ne plaît pas à l’identité dominante du département. Les publications universitaires sont désormais conçues pour présenter non pas des plats réchauffés, mais des aliments déjà mâchés. Le politiquement correct est la dystopie de la stagnation intellectuelle.
Les conséquences néfastes de la censure identitaire ne se limitent pas aux arts plastiques et à la musique, à la littérature, aux études sociales. Dans tous les domaines de l’activité humaine, la liberté d’expression et la confrontation des opinions engendrent la créativité, et il ne peut y avoir de productivité économique sans originalité intellectuelle. Les régimes dictatoriaux ont tenté de résoudre le problème en confinant le débat aux sciences naturelles et en limitant la censure et les impositions idéologiques aux études sociales, à l’art et à la fiction. Mais je constate avec inquiétude qu’un chemin convergent est emprunté dans les universités et les musées des démocraties occidentales, où l’hégémonie acquise par l’identitarisme dans l’art et les sciences sociales a permis aux sciences – c’est-à-dire aux sciences naturelles – de rester à l’abri du fléau. Cette dichotomie peut-elle être maintenue, et pour combien de temps ? Si l’identitarisme déborde sur le domaine scientifique, la catastrophe culturelle se transformera en calamité mondiale.
4
Dans un cadre nationaliste, le Sud global inclut tous les identitarismes.
Si l’inspiration biologique de l’identitarisme lui confère le caractère d’un racisme, et si la notion d’anti-identité et la circulation entre biologie et idéologie révèlent la matrice nationale-socialiste de ce racisme, la tradition nationaliste constitue un autre lien qui relie les identitarismes aux fascismes. Dans cette perspective, l’identitarisme actualise le nationalisme à l’ère de la transnationalisation économique. D’une part, il est transnational, puisque la définition de chaque identité par la couleur de la peau, le sexe ou les préférences sexuelles transcende les frontières. Mais d’autre part, chaque identitarisme a hérité du nationalisme la mémoire mythique, l’aspiration à la suprématie, le désir d’expansion, le ressentiment associé à l’agressivité.
En 1931, Paul Valéry dressait un portrait impitoyable du nationalisme : «L’histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l’intellect ait produit. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère les réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines [20] .»
Remplacez les nations par les identités, et ces lignes n’ont pas pris une ride. Puisque la notion d’une anti-identité est indispensable aux identitarismes, dans la mesure où elle leur sert à se définir de façon négative, les identitarismes s’inscrivent dans la lignée des nationalismes anti-impérialistes – le caractère fallacieux d’un concept est étroitement lié à celui de l’autre.
Au cœur de cet enchevêtrement de questions on trouve le concept de nation prolétaire, générateur de tout fascisme, et même dans les variations de sa formulation, ce concept anticipait l’histoire future. Tout d’abord, il fut conçu durant la première décennie du XXe siècle au Japon par Kita Ikki* et en Italie par Enrico Corradini [*], ce qui indique l’étendue de l’espace mondial dans laquelle le fascisme allait opérer. De plus, il provient à la fois de la gauche, à laquelle appartenait
Kita, et de la droite, où se situait Corradini, et le fascisme, jusqu’à aujourd’hui, n’a jamais cessé de résulter d’un croisement permanent de ces deux extrêmes.
Les nations prolétaires se définissaient par opposition aux nations ploutocratiques. Mais si, pour le marxisme, les prolétaires voulaient cesser d’être des prolétaires dans la mesure où ils voulaient éliminer le capitalisme, pour les tenants de la nation prolétaire, il ne s’agissait pas d’abolir les frontières, mais seulement de s’assurer que la nation prolétaire cesse d’être une nation prolétarienne en favorisant son expansion et son enrichissement. Tout nationalisme contient en germe un impérialisme – telle est la question cruciale.
Lorsque Mussolini lança l’armée italienne à la conquête de l’Éthiopie, il déclara dans un discours : «la guerre que nous avons commencée sur les terres d’Afrique est une guerre de civilisation et de libération», et expliqua : «C’est la guerre des pauvres, des déshérités, des prolétaires». Et la radio officielle de répéter que «pour la première fois dans l’histoire des guerres coloniales, il s’agit d’une guerre prolétarienne». Sans doute, parce que c’était la guerre d’une nation prolétaire qui, en conquérant une immense colonie, voulait abandonner cette condition et devenir ploutocrate. Comme je regrette que la gauche actuelle ne lise pas ce que les fascistes ont écrit et déclaré ! Mais elle risquerait d’y retrouver le reflet de son image.
En Allemagne, la montée du parti nazi s’est nourrie de l’évocation incessante des conditions imposées par le traité de Versailles, et ce fut aussi le thème de l’affrontement avec le Parti communiste [21] , chacun cherchant à montrer qu’il était l’adversaire le plus acharné des diktats des vainqueurs de 1918. En luttant contre tout ce que le traité de Versailles avait symbolisé, Hitler légitima son régime aux yeux de la population, il justifia le déclenchement de la guerre mondiale et lança son rêve de colonisation des terres slaves. La gauche nationaliste devrait lire les discours dans lesquels Hitler critiqua le grand capital de l’Entente puis les États-Unis de Roosevelt. Peut-être réfléchirait-elle ?
De même, le fascisme militaire japonais se donna pour mission de combattre l’impérialisme européen et américain, et il définit son propre impérialisme dans la «Sphère de coprospérité» et prit part à la guerre mondiale en défendant le slogan «L’Asie aux Asiatiques». De véritables précurseurs du décolonialisme !
L’histoire a maintes fois démontré que tout nationalisme anti-impérialiste contient la promesse, ou la menace, d’un nouvel impérialisme. Nous ne devons pas l’oublier si nous voulons comprendre la dynamique des événements qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.
Le tiers-monde représentait, même sur le plan terminologique, la résurgence de la nation prolétaire dans les nouvelles conditions de l’internationalisme économique. Tiers-monde vient du français, mais tiers est une forme archaïque de troisième, dont les traductions obscurcissent entièrement le sens. Le mot tiers renvoie à une expression historique, bien connue à l’époque de la Révolution française : le tiers état désignait tous ceux qui n’appartenaient ni au clergé, ni à la noblesse, ni à la bourgeoisie anoblie. La nation prolétaire d’avant la Seconde Guerre mondiale se transforma ensuite en tiers-monde, monde équivalant à nation à l’époque de l’internationalisme économique et tiers renvoyant à la notion de prolétariat.
La dynamique fut la même que celle de tout nationalisme anti-impérialiste, dans une mesure plus modeste mais non moins efficace, comme le montre l’envie avec laquelle certains pays du tiers-monde ont regardé et regardent leurs voisins. L’invasion de l’Ukraine par l’armée de la Fédération de Russie, soutenue par une milice privée funeste, constitue la dernière expression, désormais véritablement archaïque, de l’impérialisme anti-impérialiste. Les prétextes sont du même type : la menace latente que représente l’impérialisme des États-Unis et de l’Union européenne. Cette évocation de l’anti-impérialisme suffit à légitimer la version russe de l’impérialisme, qui tente de conquérir et d’annexer un pays voisin. Le fait qu’une vaste gauche poutinienne [22] applaudisse l’aventure militaire russe montre à quel point cette gauche se soumet à la dialectique fasciste de la nation prolétaire. Cependant, avec l’effondrement de l’Union soviétique, la réalité politique du tiers monde s’est étiolée parce qu’elle était trop étroitement liée à la guerre froide, et l’opération idéologico-militaire de Poutine nous donne une nouvelle indication sur le caractère dépassé de son régime.

Le tiers-monde est réapparu sous la forme du Sud global, et il ne s’agit pas d’une simple substitution de mots, parce que, au sein d’un cadre nationaliste, le Sud global inclut tous les identitarismes. Par un réflexe négatif inévitable, on définit un Nord global qui abrite l’anti-identité. Expression ultime de cette fusion du nationalisme et de l’identitarisme, la notion économique d’impérialisme se transforme en une insulte nationale et raciale, dirigée contre les Nord-Américains et les Européens en tant que peuples. La notion de Sud global synthétise cette réalité complexe. La géopolitique englobe désormais non seulement les entités nationales, mais aussi les identitarismes, ce qui confirme une fois de plus qu’ils actualisent le nationalisme à l’ère de la transnationalisation.
Le silence discret du mouvement noir [23] vis-à-vis de la situation en Afrique illustre également l’imbrication entre identitarisme et nationalisme. Aujourd’hui, aucun autre continent que l’Afrique ne connaît une corruption gouvernementale, des détournements de fonds, un enrichissement parasitaire et un mépris des pauvres aussi élevés et ostentatoires. Sans compter les guerres civiles qui, comme d’habitude, martyrisent ceux qui sont pris entre deux bandes rivales. Ce silence indique que, ici et là, on retrouve les mêmes élites, ou les mêmes candidats à intégrer l’élite, et l’on voit ainsi quel type de politique le mouvement noir soutient ou veut appliquer. Les manifestations de racisme à l’intérieur des pays africains, non seulement entre ethnies traditionnellement rivales, mais aussi entre travailleurs locaux et immigrés sont peut-être des phénomènes plus graves encore, parce que plus cachés et moins connus. Des frictions quotidiennes aux guerres fratricides, combien de centaines de milliers de morts ce racisme des Noirs contre les Noirs a-t-il déjà causé dans l’Afrique indépendante [24] ?
On touche là au cœur du problème, parce que le racisme n’est pas une question de couleur de peau, et que le terme de mouvement noir n’indique nullement de quels «Noirs» il s’agit. De même, les campagnes justifiées que les mouvements identitaires féministes, gays et trans mènent contre l’ostracisme et la discrimination dans les pays occidentaux contrastent avec l’indifférence et le silence qu’ils entretiennent face à des situations bien plus graves et généralisées qui prévalent dans de nombreux pays du Sud global.
Cette asymétrie montre une fois de plus la dynamique d’ascension sociale qui inspire à la fois les identitarismes et les nationalismes. Au fond, ils partagent les mêmes intérêts économiques et les mêmes hypothèses politiques que les élites dirigeantes des pays du Sud [25] .
Pendant ce temps, de l’autre côté du fossé des classes, on assiste à la mondialisation du marché du travail, qui donne lieu à d’importants mouvements migratoires, accélérés par la mauvaise gouvernance et les guerres internes dans les pays d’où viennent les immigrés. Quelles que soient les barrières politiques érigées, la pression des marchés est plus forte et l’immigration inéluctable. Cependant, dans les pays d’accueil, les immigrés se trouvent en concurrence sur le marché du travail avec la main-d’œuvre locale moins qualifiée, ou dont les qualifications ne présentent plus d’intérêt, ce qui exerce une pression à la baisse sur les salaires. Cette concurrence constitue la base sociale de l’hostilité aux immigrés exprimée dans plusieurs pays européens et aux États-Unis, hostilité qui se traduit par la montée électorale des partis populistes, d’extrême droite ou crypto-fascistes. Une fois de plus, la classe ouvrière connaît des contradictions internes que la gauche s’obstine à ignorer, et le fait qu’aujourd’hui les travailleurs n’existent pas sociologiquement en tant que classe ne fait qu’exacerber ces contradictions.
Malgré les obstacles, les immigrés continuent d’arriver parce qu’ils fuient la misère et que les patrons ont besoin d’eux. Souvent, ils vont travailler pour des réseaux de recrutement de main-d’œuvre organisés par des mafias de la même ethnie, qui les séparent des travailleurs locaux. Et dans de nombreux cas, ils s’installent également dans des quartiers ou des immeubles où vivent d’autres immigrés de la même origine, réduisant ainsi au minimum leurs contacts avec la population du pays d’accueil. Mais les marchés exigent la mobilité qui, avec le temps, l’emporte sur les barrières, et plus ou moins rapidement, ou lentement, les relations entre travailleurs d’origines différentes se resserrent, la main-d’œuvre se mélange, les ghettos d’habitation se diluent et l’on s’achemine vers une fusion culturelle qui assure une assimilation mais esquisse aussi l’indispensable réorganisation sociologique de la classe ouvrière.
Dans ces conditions, les mouvements identitaires démontrent clairement leur action néfaste en s’efforçant d’accentuer les divisions sociales et géopolitiques, en brandissant l’argument fallacieux selon lequel la formation d’un cadre culturel commun empêcherait le maintien de certaines traditions. Or, tous les pays, aussi petits soient-ils, rassemblent des cultures variées, qui renforcent l’ensemble au lieu de le diluer. Mais de même que les identitaires cherchent à diviser la population de leur pays d’origine selon des critères qui conduisent à la démarcation des identités, de même ils font appel à des critères ethniques, culturels et géopolitiques qui divisent les communautés immigrées et accentuent le fossé qui les sépare de la population locale. Ainsi, l’action des identitaires converge avec le populisme des partis d’extrême droite et crypto-fascistes, exactement comme il y a cent ans Marcus Garvey [*], qui se vantait d’avoir inventé le fascisme [26] , convergeait avec le Ku Klux Klan. Pour l’instant, l’audience de ces tentatives identitaires ne dépasse guère les cercles universitaires, mais en sera-t-il toujours ainsi ?

Dans ces milieux, on affirme souvent qu’au lieu de se diviser, les identités peuvent s’entrecroiser et établir ainsi une autre forme d’unité. Cette formulation théorique ne résiste cependant pas à la vérification empirique, parce que le croisement des identités a eu pour seule conséquence de les multiplier à l’infini et de multiplier les conflits entre elles. Par exemple, lorsque des identités fondées sur la couleur de la peau croisent d’autres identités fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle, des conflits surgissent pour savoir laquelle l’emporte et on assiste à la formation de nouvelles identités qui combinent les traits des identités d’origine. En outre, certaines identités s’opposent frontalement, comme les féministes et les «trans» qui étaient à l’origine des hommes mais affirment avoir assumé le genre féminin ou, à l’inverse, les homosexuels et les trans qui étaient à l’origine des femmes et déclarent avoir assumé le genre masculin.
Combinés aux distinctions géopolitiques renforcées par la notion de Sud global, les identitarismes n’ont fait qu’accentuer la fragmentation qui existe déjà parmi les travailleurs et l’aggraver par de nouvelles divisions. Je ne pense pas qu’il soit possible d’admettre que les résultats de leurs actions seront différents à l’heure où les flux migratoires s’accroissent : ils ne contribueront qu’à isoler et affaiblir les immigrés face à l’offensive des populismes.
5
L’écologie et l’identitarisme partagent la notion de «récit» et une croyance en la symétrie des enchaînements temporels. Ils alimentent ainsi conjointement la mythologie de notre époque.
Engendré dans un croisement interrompu entre la gauche et la droite et prétendant surmonter les inconvénients du capitalisme, sans abolir le capitalisme lui-même, le fascisme est un tissu de contradictions et ressemblerait à un patchwork s’il n’avait pas acquis une consistance en tant qu’invention esthétique. L’esthétique est l’empire de la forme : celle-ci en est le véritable contenu, ce qui lui permet de surmonter, dans sa dimension spécifique, les contradictions à l’œuvre sur les autres plans. Sous le fascisme, les rituels publics auxquels participaient les masses incarnaient la synthèse esthétique par excellence, et tous les autres arts (la peinture, la sculpture, la musique, et même l’urbanisme) étaient subordonnés au rituel comme des éléments qui, isolés, assumaient une fonction seulement décorative. La société que le fascisme voulait construire prenait corps et substance dans les rituels publics des masses. Cette mise en scène totale reléguait la vie quotidienne à une place secondaire, épisodique, et l’esthétique conférait ainsi aux rituels la supériorité d’un mythe. Le fascisme a seulement acquis le caractère qu’il souhaitait en tant que mythe, et l’invention esthétique lui fut utile à cet effet.
Si la pratique authentiquement fasciste, en tant que pratique esthétique, assumait à elle seule la cohérence, elle devenait à ce niveau une véritable liturgie, la représentation d’un mythe. Sans les grands rituels publics des masses, le fascisme se serait désarticulé sous l’effet des tensions entre ses éléments contradictoires ; ces dramatisations le soutenaient au seul niveau possible, en le transformant en fabricant de mythes. Les fondations du fascisme ne reposaient pas sur des mythes déjà existants, bien que ses allusions historiques pussent être trompeuses, mais il engendra toujours ses propres mythes. Le fascisme transforma le présent, tout comme le passé, et les érigea en mythes. Le cas du salazarisme est illustratif, car en justifiant l’Estado Novo [*] comme une évocation du passé, le présent apparut comme le mythe du passé, et non l’inverse – et telle fut la spécificité esthétique du fascisme portugais. Tous les fascismes s’imposèrent comme des mythes, et leurs dirigeants en firent grand usage pour fabriquer leur image.
«Nous avons créé notre mythe, proclama Mussolini quatre jours avant la Marche sur Rome [*]. Et nous subordonnons tout le reste à ce mythe, à cette grandeur que nous voulons transformer en une réalité complète.» Lui faisant écho, ses partisans proclamaient «Mussolini est un mythe» ; il se créa ce rôle et le joua presque jusqu’au dernier jour. Mais, parmi tous, le cas d’Hitler est véritablement exemplaire, car il n’incarnait pas seulement le chef ; le Führer était bien plus que cela et bien autre chose : l’émanation mythique même de la Race.
Or, la notion actuelle de récit joue un rôle fondateur dans la création des mythes par les fascistes du post-fascisme. En plantant le décor, les récits donnent aux mythes leur substance.
Tout d’abord, ce que l’on appelle aujourd’hui le récit se distingue des autres types d’expression par sa dimension autoréférentielle ; et, s’il semble mentionner une réalité extérieure et indépendante, il ne le fait que de manière métaphorique. Véritable précurseur, Salazar affirmait déjà en 1938 qu’en politique «tout ce qui semble est», de même qu’il avait déclaré cinq ans plus tôt que «politiquement, seul existe ce que connaît l’opinion publique».
La réalité matérielle et les faits se dissolvent dans les «récits». La nature symbolique du langage sert de point de départ pour considérer que, directement ou indirectement, tout se réduit à des symboles ; au lieu que le langage soit, d’une certaine manière, transparent et exprime quelque chose, il se limite à une expression de lui-même et se transforme en un décor opaque formé par un réseau de symboles. Il est inutile de se demander quelle relation le langage entretient alors avec la réalité, puisque la seule réalité que l’on puisse atteindre serait le langage. La notion de récit sous-tend le caractère esthétique du fascisme postfasciste, en tant que créateur de mythes. Il enveloppe la réalité dans des mots qui, tout en prétendant la symboliser, la recouvrent et la remplacent par une mythologie des temps nouveaux. Au lieu de servir à aller plus loin et à voir autre chose, le langage sert de miroir à sa propre image ; véritable toile de fond, il recouvre toute la réalité, et fournit la substance dont se nourrissent les mythes.
Si le langage devient un tissu de symboles soudé à la réalité, changer les symboles reviendrait à changer la réalité. Toute transformation possible consisterait à supprimer des symboles et à en engendrer de nouveaux, puisqu’ils se présentent comme immédiatement réels et qu’il n’existerait pas d’autre réalité en dehors d’eux. Le dictionnaire est devenu le lieu privilégié des disputes sociales, désormais réduites aux conflits identitaires. Et la censure, qui auparavant interdisait seulement certains propos ou supprimait la référence à des faits, se met désormais à falsifier les textes. Là où l’auteur avait écrit une chose, en utilisant certains mots, on utilise de nouveaux mots pour raconter une chose différente, et ainsi remplacer la réalité que l’auteur avait voulu transmettre par une autre. Souvent, on s’acharne sur des termes parce que l’on ignore leurs racines étymologiques, mais l’ignorance et la confusion massives des identitaires, dans ce cas comme dans d’autres, ne sont jamais corrigées : elles servent à enraciner la croyance en de fausses identités. L’expansion tentaculaire des mythes ne se limite cependant pas à ce simple processus.
Il est courant d’expliquer l’irréversibilité du temps par le deuxième principe de la thermodynamique [27] . En réalité, le temps, avec tout ce qu’il inclut, est asymétrique ; il ne se déplace que du passé vers le futur, mais jamais en sens inverse. Or, la transformation de la censure en la fabrication de nouveaux récits, grâce à l’adultération de la terminologie et à la substitution des contextes, s’étend au renversement des statues, au changement des titres des tableaux et des sculptures, à la réorganisation des salles de musée, bref, à la construction d’un décor qui présente le mythe d’un passé différent. Et lorsque des mots sont censurés parce que l’on ignore leur étymologie, qu’on leur attribue un sens erroné, on altère l’origine même des symboles, au plus profond de leur passé. Il ne s’agit pas de réinterpréter le passé (ce travail, l’historien l’accomplit régulièrement quand il propose une nouvelle explication face à d’autres interprétations antérieures) mais de changer l’image même du passé. Comme l’on réduit tout à des symboles et que l’on utilise les images comme des symboles, on considère que la substance du passé a été changée. Là où l’humanité cherchait jusqu’à présent à changer l’avenir, le fascisme identitaire se targue d’avoir changé le passé. L’identitarisme a rendu symétrique le déroulement du temps, atteignant ainsi l’apogée du mythe.
Le mouvement écologiste partage la même notion de réversibilité du temps lorsqu’il imagine la destruction du capitalisme non pas comme son dépassement grâce à la restructuration des rapports sociaux de production et la réorganisation des techniques, mais comme un anéantissement social et matériel. L’idée que le capitalisme puisse être effacé de l’histoire, avec toutes ses traces, en ressuscitant une supposée situation antérieure, résulte des notions de «récit» et d’altération du passé. De la technologie capitaliste, vue comme un récit matériel, il ne resterait plus aucune technique qui puisse être articulée autrement ; et le retour à un passé qui n’a jamais existé nous offre la nouvelle version du vieux mythe du Paradis perdu. Les deux composantes du fascisme postfasciste, l’écologie et l’identitarisme, partagent la notion de récit et la symétrie du déroulement du temps ; elles soutiennent ainsi ensemble la mythologie de notre époque.

En effet, la possibilité d’opérer cette transformation mythique du temps est implicite dans l’une des façons dont l’identitarisme prolonge le racisme du Troisième Reich. Lorsque j’ai expliqué auparavant le caractère racial de l’identitarisme, j’ai montré qu’il avait hérité du national-socialisme la notion de circularité entre la biologie et l’idéologie. Or, la première partie de ce parcours, qui cherche à établir une relation causale entre certaines caractéristiques physiques et certaines aptitudes intellectuelles, suit la direction asymétrique du temps, du passé vers le futur. Mais lorsque le parcours se poursuit dans une seconde partie, où certaines idées et certains idéaux provoqueraient l’acquisition d’une autre biologie – idéelle, mais considérée comme non moins réelle, puisque toute la réalité se résumerait à la dimension symbolique -, alors la marche du temps s’inverse, en accordant une existence à ce qui, d’une certaine manière, aurait dû exister dès l’origine. Cette circularité des enchaînements causaux entre biologie et idéologie est inhérente aux processus de sélection nécessaires à l’application de la politique des quotas, par exemple dans le mouvement noir brésilien, lorsqu’on évoque les «pardos [*] [métis, ou «sans couleur définie»] socialement blancs», mais on la retrouve aussi, d’une manière marquée ou diffuse, dans d’autres identitarismes.
L’exemple le plus frappant est peut-être la notion de «trans». Le clivage sexe/genre et la conviction qu’il est possible de changer de genre présupposent la deuxième partie du parcours circulaire entre biologie et idéologie : le changement de genre est censé impliquer l’adoption virtuelle d’un autre sexe, et l’on refait ainsi idéalement ce que la nature aurait oublié de faire physiquement. Il s’agit d’obtenir un sexe censé avoir existé dans le passé et qui serait aujourd’hui corrigé. Le simulacre peut se limiter au choix des mots et des vêtements, ou aller plus loin et entraîner des mutations physiques annexes, mais tout se réduit à des symboles dans un décor, c’est-à-dire à un récit. Et là, dans ce récit d’une biologie spectrale, la symétrie imaginaire du temps crée un autre passé et la construction de mythes assume l’une de ses expressions extrêmes.
Nous arrivons ainsi au cœur du problème. L’identitarisme, par nature, fabrique des mythes et il partage donc le caractère distinctif de tout fascisme.
Lorsque nous quittons cette dimension diaphane et posons les pieds sur terre, les conséquences sont fatales. Si le mythe est constitué comme une vérité alternative, dans le présent mais aussi projetée dans le passé, et si chaque personne est complètement entourée par le décor qu’elle construit, ou que d’autres construisent pour elle et qu’elle accepte comme sien, alors on fait disparaître l’inattendu provoqué par de nouveaux faits et même par la découverte de faits auparavant oubliés ou ignorés. Le choc avec le domaine empirique est annulé, car les identitaires se drapent dans une mythologie qui les protège. Or, l’élaboration de questions nous sert à y réfléchir en tant que questions, comme un champ ouvert. Ainsi procède l’activité scientifique : elle remet en cause ce qui a déjà été pensé ; elle provoque l’inquiétude et le doute ; elle se méfie des certitudes. Les questions sont plus importantes que les réponses, et la première démarche à entreprendre lorsqu’on obtient une réponse est de s’efforcer de la transformer en question. Mais cette démarche est impossible pour ceux qui s’entourent de récits fabriqués pour correspondre aux désirs de chaque identité et se préserver de toute contestation.
Aux yeux de la gauche du fascisme postfasciste, tout est expliqué à l’avance, et avant même que les questions ne soient posées, les réponses sont déjà connues.
Remarques de João Bernardo suite à la question d’un lecteur
Cher Irado,
Une comparaison permet de comprendre la spécificité du fascisme dans le spectre politique. Celui qui veut écrire une histoire du marxisme, du libéralisme ou du conservatisme peut se limiter au courant politique qu’il analyse et n’aborder qu’accessoirement l’influence exercée par les autres courants. Ainsi, on peut retracer la généalogie de chacun de ces trois courants, dans laquelle on observe des réorganisations et des transformations, mais sans que se produisent des ruptures ou des interruptions. Le contraire se passe pour le fascisme, qui n’a pas de généalogie propre et se réfère constamment aux autres courants politiques.
Je définis le fascisme comme une «révolte au sein de l’ordre», c’est-à-dire un écho de la gauche (la révolte) dans le camp de la droite (l’ordre), avec l’inévitable mouvement réciproque, un écho de la droite dans le camp de la gauche. Par conséquent, le fascisme ne possède pas une généalogie ininterrompue ; il s’engendre en continu, ou par vagues successives, chaque fois que la gauche, dans ses nouvelles formes, croise les nouvelles formes assumées par la droite ou converge avec elles. J’utilise l’expression de «fascisme post-fasciste» justement pour souligner cette succession de générations.
Le fasciste Maurice Bardèche a écrit en 1961 l’un des livres les plus lucides sur le fascisme – Qu’est-ce que le fascisme ? – et il anticipait le fascisme à venir : «Sous un autre nom, sous un autre visage, sans rien qui soit la projection du passé, figure d’enfant que nous ne reconnaîtrons pas, tête de jeune Méduse, l’ordre de Sparte renaîtra […].» «Pourvu que le mot fascisme ne soit jamais prononcé, observait Bardèche dans cet ouvrage, les candidats au fascisme ne manquent pas.»
Tel est le fascisme post-fasciste, un fascisme que les fascistes d’antan ne reconnaîtraient peut-être pas et dans lequel le mot fascisme n’est pas prononcé. Et pas seulement dans le présent, mais aussi dans la vision du passé, car en effet, tant que ce mot n’est pas prononcé, on lit Céline, Ezra Pound, Cioran, Heidegger, Jung et tant d’autres. C’est pourquoi j’insiste – en vain, bien sûr – pour que la gauche lise les auteurs fascistes. En vain, parce que la gauche a précisément besoin de ne pas les lire. Et elle diffuse donc une notion conventionnelle du fascisme, qui dissimule tout ce que le fascisme a de spécifique.
Un autre aspect complique la question : le manque d’homogénéité au sein du fascisme. Il s’agit, en quelque sorte, d’un corollaire puisque le fascisme se forme au croisement entre la gauche et la droite, grâce aux échos réciproques d’un camp dans l’autre. Le losange dessiné par les deux axes, horizontal et vertical, permet un graphique mobile, impossible à représenter dans un livre, mais que j’ai utilisé pendant mes cours. Selon les variations du poids du camp conservateur ou du camp radical, des milices ou des syndicats, du parti ou des milices, de l’armée ou des Églises, les côtés du losange croîtront ou diminueront, de sorte que le losange sera rarement symétrique. Mais les conséquences sont encore plus drastiques. L’hétérogénéité dans le camp du fascisme ne peut être comparée aux purges menées au sein du marxisme, car il ne s’agissait pas de simples scissions, mais de véritables guerres. Les cas de la Roumanie et de l’Autriche sont exemplaires, mais aussi ceux du Japon et de la Hongrie.
Avec mes études sur le fascisme, je m’efforce de procéder de la même façon qu’avec tout ce que j’écris: je laisse le travail ouvert, afin qu’il puisse être poursuivi par d’autres, en empruntant des voies différentes s’ils le souhaitent, et dans des directions qui ne sont pas les mêmes. C’est dans ce cadre qu’interviennent tes questions, non pas pour que j’y réponde, mais pour que d’autres personnes le fassent, par exemple toi-même.
6
Que signifie être révolutionnaire dans une situation non révolutionnaire ?
Nous voilà arrivés au monde dans lequel je vis aujourd’hui.
Certes, l’écologie et l’identitarisme n’exercent leur influence que dans les pays les plus développés économiquement et dont la forme de gouvernement est la démocratie représentative, mais le prestige dont jouit ce groupe de pays, ou du moins l’envie dont ils sont l’objet, fait que les questions soulevées par les identitarismes et l’écologie ont des répercussions sur l’ensemble de la planète.
Dans un sens convergent, les mouvements écologistes et identitaires sont myopes, voire aveugles, lorsqu’il s’agit de pays qui ne bénéficient pas de la démocratie représentative et du progrès économique. Sinon, le mouvement noir dénoncerait les atrocités que les élites noires africaines commettent contre les travailleurs noirs dans leur propre pays ; les mouvements féministes donneraient la priorité à la situation précaire des femmes dans les pays que les identitaires considèrent comme des victimes de «l’eurocentrisme blanc» ; et les mouvements gays se mobiliseraient bruyamment contre la façon dont l’homosexualité est persécutée dans ces pays. Parallèlement, et souffrant de la même myopie, les mouvements écologistes oublient d’analyser la situation économique des pays où l’agriculture est maintenue dans des conditions archaïques, et où la population n’a pas accès aux techniques développées sous le capitalisme, parce qu’ils devraient alors affronter la réfutation la plus complète des mythes qu’ils propagent.
Alors que j’écrivais ces lignes, j’ai reçu un courriel annonçant l’appel à contributions pour une conférence marxiste internationale qui se tiendra à Londres en novembre 2023 sous le nom de Sexuality and Political Economy Stream [28] . En tête de la douzaine de thèmes proposés, je suis tombé sur «Les débats marxistes dans les études queer et trans (Nord global/Sud global)», «L’économie politique du désir, du sexe et de l’érotisme», et «Les sexualités indigènes, anticoloniales et non occidentales». Les «sexualités non occidentales» sont-elles vraiment un modèle pour promouvoir les préférences érotiques queer et trans ? Un exemple, parmi tant d’autres, de strabisme identitaire.
Il est dommage que ce colloque ait choisi de se réunir à Londres plutôt, par exemple, qu’à Kampala ou à Téhéran, des villes qui peuvent se revendiquer plus «anticoloniales» et «non occidentales» que la capitale britannique. Les participants à la conférence y feraient peut-être une expérience intéressante, non pas tant sur le plan théorique que pratique. Et pourquoi se limiter à l’Iran et à l’Ouganda ? Les parlements du Kenya, de la Tanzanie et du Sud-Soudan présentent également des projets de loi visant à punir l’homosexualité de peines très sévères, y compris de la peine capitale. Selon le député kenyan Mohamed Ali [29] , ce paladin des «sexualités non occidentales», l’homosexualité serait une invention occidentale dont l’acceptation aurait été imposée au continent africain.
De part et d’autre, l’écologie et les identitarismes se limitent aux démocraties représentatives économiquement développées ;nous devons donc analyser les conséquences politiques immédiates du post-fascisme dans ces régions du monde.
Depuis sa création, le capitalisme repose sur la combinaison de la forme classique de pouvoir que je qualifie d’État Restreint (composé du gouvernement, du parlement et des tribunaux), et de l’État Élargi (composé des entreprises en tant qu’organes souverains, puisqu’elles détiennent légalement un vaste champ d’autorité sur leur main-d’œuvre et qu’elles l’exercent même en dehors des heures de travail). En outre, les plus grandes entreprises exercent une influence non seulement économique mais aussi culturelle sur la société dans son ensemble. Or, les ordinateurs personnels et Internet permettent de lier étroitement l’État Élargi et l’État Restreint : dans toute l’histoire de l’humanité, ils sont le seul instrument qui serve à la fois d’outil de travail, de moyen de loisir et d’outil de surveillance. Ils permettent de fusionner le pouvoir souverain des entreprises, pendant les heures de travail et en dehors de celles-ci, et celui de l’État classique. Cette capacité d’intrusion s’est multipliée avec la généralisation des mini-ordinateurs de poche que sont les téléphones mobiles. Ces dernières années, grâce au développement de la réalité virtuelle et maintenant de l’intelligence artificielle, les outils de surveillance que sont les ordinateurs ont accédé au domaine intime des désirs et aspirations inconscients. C’est dans ce réseau complexe qu’existe et prospère le fascisme postfasciste.
Et nous constatons des paradoxes étonnants :
– les versions ethniques de l’identitarisme, toujours prêtes à critiquer «l’eurocentrisme» et à plaider en faveur du «Sud global» et de «l’épistémologie du Sud [30] », acceptent sans la moindre réserve les ordinateurs et Internet, même si les fondateurs de la physique quantique étaient tous européens ou élevés dans la culture européenne ;
– les féministes ne rejettent pas la physique quantique, bien que celle-ci – à une exception près – ait été créée par des hommes, et pire encore, par des mâles hétérosexuels ;
– enfin, malgré leur hostilité non seulement à la technologie capitaliste mais aussi aux techniques qui la composent, les participants aux mouvements écologistes épargnent les ordinateurs, Internet et les téléphones portables, sans lesquels ils ne pourraient pas vivre ni même respirer.
Or, non seulement toute l’infrastructure fondée sur les ordinateurs et Internet est acceptée, mais elle sert de cadre privilégié au fonctionnement du fascisme postfasciste. Les milices ont désormais une existence virtuelle avant tout, et, le plus souvent, on remplace le lynchage physique par une élimination morale et professionnelle, où la prétendue annulation fonctionne comme un certificat de décès. Dans le même temps, Internet facilite la délimitation d’espaces sécurisés ou sûrs, notion essentielle dans les identitarismes pour maintenir le contrôle exercé par les dirigeants sur leur base, ainsi embrigadée et préservée de toute confrontation avec d’autres opinions et pratiques.
Rien de tout cela ne serait possible sans les réseaux sociaux, qui constituent le support technique de masse aux actions du fascisme postfasciste. Le comportement le plus typique de notre époque se développe précisément sur les réseaux sociaux : la fin de la vie privée et l’ostentation de l’intimité combinent narcissisme et exhibitionnisme avec le voyeurisme correspondant. L’ordinateur ne constitue pas seulement un instrument de surveillance des agents de l’autorité, de l’État Restreint ou de l’État Élargi, sur les citoyens ordinaires. L’espionnage se démocratise tellement que tout le monde surveille tout le monde, d’autant plus que l’exhibitionnisme conduit à s’exposer délibérément à cette surveillance. Un mouvement identitaire obtient facilement des preuves de comportements et d’opinions jugés offensants et, à mesure que les identités prolifèrent et se croisent ou se concurrencent, les occasions de commettre une infraction se multiplient et les contrevenants aussi. À l’inverse, si les médias sociaux servent à faire connaître, ils servent aussi à isoler et à «annuler», à «effacer» (cancel). On utilise les mêmes moyens techniques pour définir les normes, les violer, et pour lyncher les contrevenants. Dans ce lacis de reproches et de culpabilité, chacun trouve ses propres armes et aussi la corde pour se pendre.
La multiplicité des usages des réseaux sociaux semble inépuisable, parce que la concurrence des victimes y trouve un terrain fertile. Chacun rivalise pour exhiber les tragédies de son intimité et espionner la vie privée d’autrui ; cette rivalité garantit le droit d’obtenir une «place de la parole» et d’être promu dans des mouvements identitaires, première étape d’une ascension sociale ambitieuse. Cet ensemble de circonstances et de mécanismes politiques explique la pertinence des réseaux sociaux à l’époque actuelle.
Mais le contrôle exercé sur les individus dans les démocraties économiquement développées ne se limite pas aux ordinateurs et à Internet, aussi importants soient-ils. Au-delà du virtuel, il reste le présentiel, et dans une société où les Églises organisées déclinent, deux lobbies se sont emparés du corps et de l’âme.
Le lobby des nutritionnistes s’occupe du corps : manger et boire ont cessé d’être un plaisir pour ceux qui en ont les moyens, pour devenir un rituel politique avec les écologistes ; un rituel religieux avec les végétariens et, pire encore, avec les vegans ; ou, plus prosaïquement, une sorte de passage à la pharmacie.
Le lobby des psychologues s’occupe de l’âme. En cette époque riche en paradoxes, et même si l’identitarisme a aboli la notion de normalité, les psychologues gagnent leur vie en soignant des gens qui ne se sentent pas normaux – quoi que cela veuille dire. En fait, il ne s’agit peut-être pas d’un paradoxe, mais d’un cycle qui se nourrit de lui-même : tandis que les identitaires dictent aux gens comment assumer l’identité qu’ils ont choisie, ou qu’ils ont été poussés à choisir, les psychologues promettent d’aider les gens à surmonter l’état dans lequel ils se trouvent ou, à tout le moins, à s’accepter eux-mêmes. En somme, les uns créent les problèmes que les autres prétendent résoudre, et vice versa.
Dans ce panorama, on aperçoit uniquement des options rétrogrades et individuelles. Les écologistes annoncent le retour imaginaire à un Paradis perdu de la technologie et désirent faire revivre un passé mythique. Quant aux identitaires, ils veulent que la «place de la parole» serve de vecteur d’ascension sociale pour composer et renouveler les élites. En fait, si on veut les définir socialement, il suffit de se rappeler que les notions de «place de la parole» et d’«espace sécurisé» sont nées dans le milieu universitaire et le régissent. Imaginons leur application sur le lieu de travail !
Certes, la gauche du post-fascisme se résume aux départements universitaires de sciences sociales, qui se confondent souvent avec les organisations politiques. Leur zone d’influence est cependant beaucoup plus large ; outre leur activité sur les réseaux sociaux, ces départements forment des enseignants et des journalistes, ce qui amplifie l’impact de mouvements qui, à eux seuls, n’atteindraient pas le grand public.
Ainsi, le panorama a été progressivement occupé par des lieux communs écologistes et identitaires. La réaction populaire est perceptible dans d’autres espaces et d’autres professions, à l’abri du lynchage virtuel et de l’«annulation». Malheureusement, l’antipathie ressentie par les gens ordinaires face aux exagérations des identitaires, qui ont transformé la tolérance en de nouvelles discriminations, et face aux conséquences prévisibles de la décroissance économique et du misérabilisme prêchés par les écologistes, cette antipathie conduit un grand nombre de personnes à voter pour des partis populistes, parce que la gauche marxiste s’est dissoute, ou a été absorbée, et que la droite conservatrice s’est laissée assimiler par des versions atténuées du politiquement correct.
Après la défaite de la révolution portugaise de 1974-1975 [31] , pour la première fois, je me suis demandé, avec d’autres, comment pouvait-on être révolutionnaire dans une situation non révolutionnaire. Cette question reste en suspens.

L’avenir n’est pas fixé, il est incertain, socialement et matériellement. Si l’avenir permet la poursuite de certaines tendances que nous avons découvertes dans le passé, nous ignorons pourtant quelles sont, parmi ces tendances, celles qui réussiront et serviront de fondement aux temps nouveaux. Nous ne pouvons jamais prédire l’évolution des luttes sociales. En outre, les éléments constitutifs de la technologie capitaliste peuvent également être restructurés de diverses manières et donner naissance à des technologies différentes.
J’appelle «Historiographie du Non» l’étude de cette mosaïque fragmentée, composée de nombreuses possibilités annoncées et de peu de réalités réalisées [32] . À chaque instant, nous pouvons définir exactement l’impossible et donc établir les contours du possible. Mais à l’intérieur de ces contours, le nombre de possibilités est illimité.
Leibniz considérait que toute possibilité, en tant que possibilité, assume un degré de réalité, parce qu’elle est une «prétention à l’existence [33] ». L’Historiographie du Non est l’étude de la réalité, ou du degré de réalité, de ces prétentions à l’existence. Mais nous n’avons pas ici affaire à l’Histoire, toujours écrite a posteriori, car nous sommes dans le présent et voulons anticiper l’avenir. Or, connaître les limites du possible et être capables d’exclure l’impossible ne nous aide pas à prédire lequel des possibles se réalisera. Quelles sont les prétentions à l’existence qui se concrétiseront ? Nous pouvons savoir ce qu’est une action inutile, mais sans pour autant savoir ce que sera l’action utile.
Comment se dessinent les contours du possible ? La soi-disant gauche devrait réfléchir au fait que l’identitarisme et l’écologie sont utilisés pour lancer des marques et faire de la publicité pour des produits, et qu’ils sont acceptés comme des normes ou au moins des objectifs par les États démocratiques et le capitalisme développé. Le fait que le politiquement correct soit devenu la morale officielle devrait faire réfléchir la gauche. Mais au lieu d’y voir un avertissement, elle pense qu’il s’agit d’une victoire. C’est en effet une victoire, mais pas de ce qu’elle semble être. «Détrompez-vous, nous prévient le romancier Patrice Jean, aucune prise de position, quelle qu’elle soit, dans une démocratie n’est courageuse [34] .»
Dans une perspective anticapitaliste, le champ de l’impossibilité est couvert par le fascisme post-fasciste, ses départements universitaires, ses partis et ses mouvements, les espaces qu’ils occupent sur les réseaux sociaux. Aucun germe d’anticapitalisme ne pourra y émerger ou avoir une «prétention à l’existence». Si j’ignore comment être révolutionnaire dans une situation non révolutionnaire, je sais au moins comment ne pas l’être – en acceptant de s’insérer dans une situation non révolutionnaire.
Ainsi, tourner le dos aux milieux écologistes et identitaires, ou vivre en marge de ces milieux, sans jamais collaborer avec eux, n’est pas seulement une condition de salubrité intellectuelle. Il s’agit aussi d’une exigence d’acuité politique.
João Bernardo, Passa Palavra, juillet- 1er août 2023
Les œuvres qui illustrent le texte sont d’Yves Tanguy (1900-1955), Francis Picabia (1879-1953), Paula Rego (1935-2022), Wilfredo Lam (1902-1982) et George Segal (1924-2000).
Glossaire (rédigé par le traducteur)
Chamberlain, Houston Stewart: 1855-1927, essayiste britannique qui influença les courants racistes, antisémites et nationalistes allemands puis le nazisme. Un exemple de sa prose : «Sachons reconnaître avec quelle maîtrise ils [les Juifs] utilisent la loi du sang pour répandre leur domination : la souche principale reste sans tache, pas une goutte de sang étranger ne s’y infuse – ne lit-on pas dans la Thora : «Le bâtard n’entrera point dans la maison de Yaweh, même sa dixième génération n’y entrera point» (Deutéronome XXIII, 2) ? – mais en même temps des milliers de rameaux secondaires sont détachés du tronc, qui servent à imprégner de sang juif les Indo-Européens (…)» H.S. Chamberlain, La Genèse du XXe siècle, 1899
Club de Rome : club de réflexion créé en 1968, et regroupant des scientifiques, des économistes, des hauts fonctionnaires et des industriels. Il est devenu célèbre, en 1972, après la publication de son rapport (en français, Halte à la croissance !) qui soulignait la diminution des ressources mondiales, la dégradation croissante de l’environnement et la nécessité d’un développement durable.
Codreanu, Corneliu Zelea (1889-1938 ) : volontaire pour combattre en 1916, bien qu’il soit encore mineur, il est convaincu qu’une nation est une sorte d’organisme vivant qui doit se défendre contre toutes sortes d’ennemis (juifs, catholiques, immigrés, bolcheviks, etc.). Converti à l’orthodoxie, il fait des études de droit et, malgré ses origines familiales allemandes et polonaises, devient un fervent nationaliste roumain, mais aussi un anticommuniste convaincu et un briseur de grèves militant. Il voyage en Allemagne où il fréquente les milieux nationalistes et parfait son éducation politique, puis, de retour en Roumanie, participe à diverses organisations avant de fonder, en 1927, la Légion de l’archange Michel ou Garde de fer [*], parti et milice fascistes et antisémites, qui recrute d’abord parmi les jeunes et les étudiants puis essaie de mobiliser les paysans et même les ouvriers [35] . Élu député en 1931 et en 1932, il est emprisonné et condamné à plusieurs reprises pour ses activités violentes avant d’être assassiné en taule. Plusieurs de ses écrits sont disponibles gratuitement, en français, sur Internet et diffusés par des maisons d’édition d’extrême droite.
Corradini, Enrico: (1865-1931) : professeur de lycée, directeur de revues littéraires, et auteur de romans et de pièces de théâtre, il défend des idées vitalistes et antimatérialistes. Il dénonce la «décadence morale» de la civilisation urbaine, et prône «le dépassement des factions partisanes au nom de la grandeur nationale, entravée et niée […] par les courants démocratiques et socialistes et la redoutable oligarchie libérale [36] ». Son engagement politique nationaliste devient plus marqué à partir de 1903, notamment grâce à ses activités journalistiques intenses, et il s’oppose violemment aux revendications syndicales et au mouvement ouvrier. Il défend une «ligne expansionniste-impérialiste que non seulement la bourgeoisie, mais aussi le prolétariat ouvrier lui-même, devront rejoindre une fois soustraits à l’hégémonie socialiste [37] ». Il s’inspire des idées de Barrès et Maurras, mais aussi de personnages politiques aussi divers que Gioberti, Mazzini et D’Annunzio. Corradini critique la lâcheté de la bourgeoisie, et prône la conquête de colonies plutôt que l’expansion industrielle et commerciale. Son objectif est de créer un bloc entre les syndicats et les nationalistes. Il crée l’Association nationaliste italienne (ANI) en 1910, qu’il dote d’un hebdomadaire ce qui donne un plus grand écho à sa conception selon laquelle «L’Italie est une nation matériellement et moralement prolétaire» qui doit lutter contre les nations «capitalistes-ploutocratiques» afin de développer un «socialisme national» et un «esprit militaire agressif de nature révolutionnaire [38] ». Il soutient à fond l’intervention italienne en Libye à partir de 1911. «Corradini distinguait au sein de la bourgeoisie une bourgeoisie intellectuelle, une bourgeoisie politique et une bourgeoisie de producteurs : cette dernière seule était une force saine, et s’opposait à la vieille bourgeoisie politique pacifiste et matérialiste : la seule démocratie acceptable était une démocratie de producteurs dans laquelle capitalistes et prolétaires pouvaient trouver une composition de leurs intérêts [39] .»
Tentant de franchir un pas de plus, il se présente aux élections à la Chambre des députés en 1913 mais n’est pas élu. Corradini soutient l’entrée de l’Italie dans la guerre et crée un quotidien avec l’appui de grands patrons des «secteurs de l’acier, de la mécanique et du sucre [40] ». Dès 1921 il s’intéresse au parti fasciste et facilite l’entrée de l’ANI dans le Parti national fasciste en 1922. Nommé sénateur en mars 1923, puis ministre d’État en 1928 il est progressivement marginalisé par le régime et mis à la retraite politique durant les dernières années de sa vie.
Darré, Walther (1895-1953) : ingénieur agronome allemand, il sympathise d’abord avec le courant völkisch (nationaliste-raciste). Ami d’Alfred Rosenberg, l’idéologue officiel du nazisme, il rejoint le Parti national-socialiste en 1930 et est nommé conseiller de Hitler aux questions agricoles. A cette époque, il existe une très étroite collaboration entre Heinrich Himmler, Reichsführer SS, donc chef suprême de la SS, et son subordonné, l’Obergruppenführer SS Darré, en charge du Bureau central de la race et du peuplement à partir de 1931, organisme qui joue un rôle central dans la politique raciale nazie. De l’été 1933 jusqu’en 1942, Darré sera le «Führer des paysans du Reich» et aussi ministre de l’Approvisionnement et de l’Agriculture, avant de tomber en disgrâce.
Dühring, Eugen (1833-1921): philosophe et économiste qui avait des sympathies pour le socialisme et dont les idées influencèrent plusieurs dirigeants ouvriers de l’époque. Il écrivit au moins quatre livres contre les Juifs. Pour lui, Karl Marx était la personnification du mal, tant en raison de ses théories que de ses origines familiales.
Estado Novo : Sous la direction d’Antonio de Oliveira Salazar (1889-1970), la dictature de l’Estado Novo (l’État Nouveau) reposait sur une Constitution votée par un référendum durant lequel les femmes mirent un bulletin dans l’urne pour la première fois ; un parti unique (l’Union Nationale) ; une organisation de jeunesse (à laquelle l’appartenance était obligatoire entre 7 et 14 ans) ; et une police politique (la PIDE) aidée par un réseau de mouchards omniprésent. Idéologiquement, son régime combinait la prétendue «doctrine sociale» de l’Église avec le corporatisme fasciste, un anticommunisme fanatique, le soutien à Hitler et Mussolini et un nationalisme intransigeant, désireux de conserver son empire colonial à tout prix. «Dieu, Patrie, Famille» était la devise de ce régime qui n’oublia évidemment pas de faire l’apologie des traditions et du travail.
Garde de fer (ou de son vrai nom la Légion de l’archange saint Michel) : créé en 1927 par un instituteur (qui prit le nom de Corneliu Codreanu), ce mouvement fasciste recruta d’abord parmi les étudiants et les jeunes des classes populaires, notamment paysannes. Le mouvement se radicalisa après la crise de 1929 et créa une branche paramilitaire qui pratiqua l’assassinat politique, y compris celui d’un Premier ministre en 1933. Le parti issu du mouvement occupa la troisième place au Parlement, ce qui lui permit d’imposer une politique de plus en plus xénophobe, antisémite et favorable aux Roumains «de souche». Codreanu futt arrêté puis liquidé en novembre 1938. En 1940, les restes de la Légion s’allièrent avec le général Antonescu et la Roumanie rejoignit l’Axe l’année suivante. Les légionnaires se livrèrent alors à une série de pogromes et d’assassinats, sans oublier de pratiquer le racket à grande échelle, et bien sûr de purger les médias. Ils tentèrent mais ratèrent un coup d’Etat en janvier 1941, et durent se réfugier ensuite en France, en Espagne et en Allemagne.
Garvey, Marcus (1887-1940). Né en Jamaïque, il vint vivre aux États-Unis et créa en 1917 l’Association universelle pour l’amélioration de la cause noire (UNIA), organisation afro-américaine de masse pendant quelques années. Partisan d’un retour des descendants des esclaves noirs en Afrique, il est considéré comme un précurseur du panafricanisme. Comme tout nationaliste, Garvey tint des discours contradictoires et confus : il alla jusqu’à affirmer dans une interviews en 1937 que ses partisans avaient été les «premiers fascistes» et que Mussolini avait «copié son fascisme [41] » sur l’UNIA, tout en écrivant aussi des poèmes à la même période dénonçant la «brutalité» de Mussolini, sa «folie» et son «manque d’éducation».
Gestionnaires : Dans sa préface au livre de João Bernardo Economia dos conflitos sociais (Economie des conflits sociaux, 1991, 2e édition 2009) Maurício Tragtenberg définit les gestores (gestionnaires) en ces termes : «L’un des points les plus importants [de ce livre] traite de la structure des classes dirigeantes et souligne une bifurcation, au sein de la classe capitaliste, entre ce que João Bernardo appelle la classe bourgeoise et celle des gestionnaires. La classe bourgeoise est définie à partir d’une perspective décentralisée, c ‘est-à-dire, en fonction de chaque unité économique dans son microcosme. La classe des gestionnaires, en revanche, a une portée plus universalisatrice et est définie en fonction des unités économiques reliées à l’ensemble du processus. Toutes deux s’approprient la plus- value : toutes deux contrôlent et organisent les processus de travail : toutes deux garantissent le système d’exploitation et occupent une position antagoniste face à la classe ouvrière. Mais la classe bourgeoise et celle des gestionnaires diffèrent de plusieurs façons: 1) par les rôles qu’elles jouent dans le mode de production: 2) par les superstructures juridiques et idéologiques qui leur correspondent : 3) par leurs origines historiques différentes : 4) par leurs évolutions historiques différentes. Alors que la classe bourgeoise organise des processus particularisés visant à sa reproduction à un niveau microcosmique, la classe des gestionnaires organise ces processus particularisés en les reliant à un fonctionnement économique mondial et transnational. Il convient également d’ajouter que, pour l’auteur, la classe des gestionnaires tente parfois de se faire passer pour une classe non capitaliste, mais il ne s ‘agit que d’une apparence.»
Gestionnaires et classe bourgeoise : «La classe bourgeoise est définie à partir d’une perspective décentralisée, c’est-à-dire en fonction de chaque unité économique dans son microcosme. La classe des gestionnaires, au contraire, a une dimension plus universalisante et est définie en fonction des relations entre les unités économiques et le processus global. Les deux classes s’approprient la plus-value ; elles contrôlent et organisent toutes deux les processus de travail ; elles garantissent le système d’exploitation et occupent une position antagonique par rapport à la classe ouvrière.
Mais la classe bourgeoise et la classe des gestionnaires diffèrent à plusieurs égards : par les fonctions qu’elles exercent dans le mode de production ; par les superstructures juridiques et les idéologies qui leur correspondent ; par leurs origines historiques différentes ; et par leurs différents développements historiques.
Alors que la classe bourgeoise organise des processus particuliers afin de les reproduire sur un plan plus microcosmique, la classe des gestionnaires organise ces processus particularisés en les articulant avec le fonctionnement de l’économie mondiale et transnationale. Il convient également d’ajouter que, pour João Bernardo, la classe des gestionnaires peut prendre la forme d’une classe apparemment non capitaliste, mais ce n’est justement qu’une apparence. L’exemple de l’ex-URSS peut être très éclairant et est souvent évoqué par João Bernardo.» (Idem.)
Gottgläubige: mouvance minoritaire (3,5% de la population d’après le recensement de 1939), présent surtout dans les villes, et attirant des chrétiens nazis ayant quitté leurs Églises surtout après 1936, à cause des tensions croissantes entre les responsables catholiques et protestants et le régime national-socialiste. Cette mouvance était particulièrement influente dans la SS, d’autant que son patron, le Reichsführer Himmler, était un chaud partisan de cette idéologie confuse.
Haeckel, Ernst (1834-1919): médecin, biologiste et philosophe allemand, partisan du darwinisme social, de la supériorité raciale des Européens et du pangermanisme.
Horia, Vintila (1915-1992): diplomate, journaliste, directeur de banque, et intellectuel fasciste [42] roumain. Condamné à la prison à perpétuité en 1946 pour ses activités politiques et ses positions prohitlériennes, il consacra le reste de sa vie, après la seconde guerre mondiale, à écrire des romans et des essais, dans ses différents pays d’adoption, l’Italie, l’Argentine et l’Espagne. Il fit partie du comité de patronage de Nouvelle École, revue du GRECE dirigé par le raciste et fasciste Alain de Benoît. Une partie de son œuvre littéraire a été publiée en France dans des maisons d’édition dites respectables (Fayard, Plon, Julliard) mais pas ses écrits politiques.
Kita Ikki (1883-1937): journaliste, conférencier, initialement socialiste, il se détourne rapidement du socialisme et essaie de bricoler une idéologie combinant un nationalisme japonais non ethnique (le Japon faisait partie, pour lui, du prolétariat international), le soutien à l’empereur et à l’armée, le panasiatisme, le bouddhisme, le confucianisme, l’expansionnisme territorial et une dose de «justice sociale» (réforme agraire modérée plus quelques nationalisations), ce qui en fait l’un des idéologues de l’extrême droite qu’il rejoint en 1920. «Contrairement aux autres socialistes, Kita avait soutenu la guerre de 1904 et 1905 contre la Russie, et il développa à partir de là un patriotisme de plus en plus radical. Tant dans ses écrits que dans sa pratique, Kita combina un nationalisme agressif avec un programme de réforme prévoyant une vaste étatisation de l’économie et de nombreux droits sociaux pour les travailleurs, y compris la réglementation des relations de travail. Cela permettrait de gagner le soutien du prolétariat urbain et des paysans pauvres à une politique qui assurerait la suprématie japonaise en Asie [43] .» Il fut arrêté en 1936 puis exécuté l’année suivante pour avoir participé à une tentative de coup d’État militaire.
Légion de l’archange Saint-Michel, voir Garde de fer.
Marche sur Rome : Marche d’une petite partie des forces paramilitaires fascistes (26 000 hommes) organisée le 27 octobre 1922 par Mussolini pour faire pression sur le gouvernement libéral et le roi, et ainsi accéder «légalement» au pouvoir. Sans la «neutralité» de l’armée et l’inertie des politiciens au pouvoir, cette marche se serait terminée par un fiasco retentissant, mais le Duce la transforma par la suite en un moment épique et fondateur.
Pardos (bruns, métis, voire «sans couleur précise» [44] ) : selon George Reid Andrew [45] , les pardos représentaient environ 39% de la population nationale et 87 % des Afro-Brésiliens dans les années 1980. On comprend pourquoi, deux décennies plus tard, les Afro-brésiliens dits «noirs» (pretos, selon l’appellation du recensement, ou negros), soit à peu près 7,6% de la population totale actuelle, commencèrent à se vouloir se différencier des pardos, quand des politiques de quotas et/ou de discrimination positive furent introduites, provoquant évidemment des situations absurdes, comme «le cas rendu public par la revue Veja en 2007 : deux frères jumeaux identiques avaient postulé pour une place dans des programmes de premier cycle à l’Universidade de Brasília. L’évaluation de l’accessibilité aux actions affirmatives étant basée sur l’observation des photographies des candidats, un des jumeaux fut classifié “noir” et a eu accès aux quotas, alors que son frère fut classifié “blanc” et n’y a pas eu accès [46] ».
A propos de la nature des pardos, on retrouve l’écho d’un vieux mythe chrétien et colonialiste, mais qui est inversé dans le raisonnement des identitaires afro-brésiliens. En effet, dès le Moyen Age, des voyageurs aventureux et mythomanes, puis des missionnaires chrétiens et enfin des historiens ou des savants européens favorables à la colonisation, cherchèrent à repérer, en Afrique, des peuples dont la pigmentation ne fusse pas «trop foncée» et/ou dont les traits fussent moins «négroïdes», donc plus proches de ceux des Européens dits «Caucasiens». Certains voulaient retrouver des traces des Dix Tribus perdues d’Israël ; d’autres, ou les mêmes, souhaitaient «prouver» que certains Africains (jugés par eux plus «évolués») descendaient, au choix, d’Aryens, d’Hébreux, de Syriens ou de Grecs qui auraient apporté une civilisation «supérieure» à celles présentes localement [47].
Reprenant le même genre de raisonnement biologico-idéologique, mais en l’inversant, les identitaires afro-brésiliens se méfient des Afro-descendants pas assez «noirs» à leur goût, car eux aussi croient que le mélange des sangs «noir» (?) et «blanc» (?) aurait des effets culturels fondamentaux – ici négatifs – alors qu’ils étaient positifs pour les Euro-descendants qui prétendaient «civiliser» l’Afrique.
Dans les discours identitaires au Brésil, mais aussi aux Etats-Unis, on retrouve également des échos évidents de la vieille méfiance des esclaves de plantation vis-à-vis de ceux qui étaient obligés de travailler dans la maison du maître, les dits «nègres de maison» (Malcolm – lui-même métis – s’en fit l’écho [48] à plusieurs reprises), d’autant que les jeunes esclaves domestiques étaient violées et que leurs enfants pardos étaient mal considérés et jalousés voire haïs par les autres esclaves.
Conscient que tous ces discours qui exaltent la pureté raciale et culturelle des Afro-brésiliens noirs «de souche» sont politiquement inefficaces, vu que les pretos (ou les negros) sont minoritaires, ces identitaires affirment donc, contre toute évidence : «D’après le dernier recensement de 2014, les Noirs représentent 54% de la population du Brésil, ce qui fait du Brésil la deuxième population noire au monde derrière le Nigéria» (https://www.anacaona.fr/les-afro-bresiliens/). Et Kabengele Munanga, anthropologue congolais qui enseigne au Brésil, de rajouter généreusement quelques pour cent à ce chiffre imaginaire : selon lui, les Noirs (sous cette étiquette, il range les métis de toutes origines – y compris ceux issus d’Amérindiens et d’Européens – et les Noirs «de souche») constitueraient 56% de la population, (https://afriquexxi.info/La-democratie-raciale-bresilienne-est-un-mythe).
Pourtant, d’après les auto-déclarations recueillies lors du dernier recensement effectué au Brésil, les «Blancs» seraient 47,7 % ; les pardos (métis) 43,1%, les pretos ou negros (Noirs), 7,6%, les indigenos (Amérindiens), 0,3%, et les amarelos (Asiatiques), 1,9% – ce dernier chiffre ayant été jugé gonflé par la suite.
Les raisonnements absurdes sur les races (ou, ce qui revient au même, sur les groupes ethniques) ne peuvent que se contredire au gré des modes culturelles, des mouvements contestataires-clientélistes, des intérêts économiques et des politiques publiques opportunistes. Manipulés par les idéologues identitaires, ces chiffres n’aboutissent qu’à dresser ceux que ces idéologues jugent les «plus opprimés» (les Noirs, voire les femmes noires, ou – dernière invention – les trans noirs, tous évidemment «de souche» 100% africaine) contre les métis, complices à leurs yeux des Euro-descendants au sang «blanc» ( ?).
Tout cela serait risible, si cela n’avait pas des effets politiques néfastes.
Place de la parole : João Bernardo allusion à une expression (lugar de fala) utilisée par la philosophe afroféministe brésilienne «pro-LGBT» Djamila Ribeiro dont les éditions Anacaona ont traduit quatre livres : Petit manuel antiraciste et féministe (2020), Dialogue transatlantique. Perspectives de la pensée féministe noire et des diasporas africaines (avec Nadia Yala Kisukidi), Chroniques sur le féminisme noir (2019) et La place de la parole noire (2019). Selon le site de l’éditeur, ce dernier ouvrage «questionne qui a droit à la parole dans une société où la masculinité, la blanchité et l’hétérosexualité sont la norme. Qui peut parler ? Que se passe-t-il quand nous parlons ? Sur quoi nous est-il permis de parler ? Le concept mis en avant par Djamila Ribeiro, la “place de la parole”, ou également appelé “lieu d’élocution” veut favoriser la multiplicité des voix. Se basant sur de nombreuses références, et notamment des féministes intellectuelles noires, Djamila Ribeiro réfute la neutralité du savoir et souligne l’importance de rompre cette voix unique. Penser la place de la parole, c’est reconnaître la place d’où nous parlons, ce qui est fondamental pour réfléchir aux hiérarchies, aux oppressions et rompre avec l’histoire unique».
Ce terme me rappelle la fameuse injonction soixante-huitarde «D’où parles-tu, camarade ?» Cette question visait à obliger l’intervenant à préciser sa position de classe et aussi à savoir au nom de quelle organisation il parlait, pour éviter les magouilles dans les assemblées générales. Aujourd’hui, selon le charabia à la mode dans nos sociétés «cis-hétéro-patriarcales-eurocentrées», on se préoccupe uniquement de l’«identité du locuteur», c’est-à-dire de ses caractéristiques raciales et sexuelles. D’ailleurs, Djamila Ribeiro établit une différence entre les pretos, d’un côté, et de l’autre, les clarinhas de turbante, les moreninhos et les mulatinhos (soit les «clairettes enturbannées», les «brunillons» et «mulâtrillons», ou les «ti’ bruns» et les «ti’ mulâtres»), dans cette interview télévisée (https://www.youtube .com/watch?v=qA5u9yUNdWQ), tout cela au nom de «l’expérience spécifique» des Noirs, bien sûr 100% authentiques ! Nous ferons remarquer à Dame Ribeiro que Malcolm X et Franz Fanon étaient des mulatinhos – ce qui a dû lui échapper….
Cette hiérarchie raciale fondée sur des degrés de «colorisation» ou de «colorisme» n’a rien de très neuf puisque les propriétaires d’esclaves et les «savants» du XVIIIe siècle établissaient déjà des différences entre les «mulâtres», les «quarterons», les «câpres», les «griffons», les «octavons», etc.
Pour les racistes euro-descendants le métis est un être impur parce qu’il souille la race «blanche» ; pour les identitaires afro-descendants, le métis est un être impur dès sa naissance, voué à devenir plus tard un «collabo» – conscient ou inconscient.
Reichsmusikkammer, ou Chambre de la musique du Reich : corporation créée par les nazis pour regrouper tous les musiciens, professeurs et fabricants d’instruments. L’adhésion y était obligatoire pour travailler dans ce secteur d’activité. Son objectif était d’exalter les vertus germaniques et l’identité allemande en «purifiant» la culture selon des critères nationalistes, racistes, antisémites et xénophobes, et aussi de disqualifier toutes les musiques jugées «immorales» ou «dégénérées», soit parce qu’elles faisaient allusion à la sexualité, soit parce qu’elles étaient composées et/ou jouées par des non-Aryens, des opposants politiques, des Afro-descendants, des Juifs, etc. Les nazis étaient hostiles aussi bien à la musique atonale qu’au jazz, au swing, voire à certaines opérettes. Cette institution dépendait du ministère du Reich à l’Éducation du peuple et à la propagande, dirigé par Joseph Goebbels, et elle réglementa favorablement les horaires et les salaires des musiciens pour acheter leur soutien politique. Pendant toute la guerre, le régime organisa des concerts et des spectacles de théâtre sur le front, ou à proximité, pour entretenir le moral des soldats. Pour les nazis, l’art avait une fonction politique essentielle.
Steiner, Rudolf (1861-1925) : écrivain autrichien, conférencier, enseignant et dramaturge, il n’est pas le fondateur de l’anthroposophie, même si son nom en est indissociable. «[…] le lien entre l’écologie et l’agriculture fut pensé par Rudolf Steiner en 1924, quand il lança l’idée de l’agriculture biodynamique. […]. Steiner transposa la hiérarchie mystique de la progression spirituelle vers une hiérarchie biologique de la succession des races, dans laquelle la position la plus récente, et donc supérieure, revient à la race aryenne, dont la composante la plus parfaite serait l’élément germano-nordique. La fusion d’une hiérarchie spirituelle avec une hiérarchie raciale plaçait l’anthroposophie dans le même camp idéologique que celui où se développa plus tard le racisme hitlérien. C’est dans ce contexte que Steiner formula sa théorie de l’agriculture biodynamique, inspirée par l’idée que la terre serait un organisme vivant et par sa prétention de connaître les forces cosmiques invisibles censées influer sur les sols et la flore. Rudolf Steiner mourut en 1925 et, peu de temps après, cette forme d’agriculture commença à être promue par Walther Darré. [49] ««Ministre du Reich pour l’approvisionnement et l’agriculture, Führer des paysans du Reich et directeur du Département central de la SS pour la race et la colonisation avec le rang d’Obergruppenfuhrer, le deuxième rang le plus élevé dans la SS, Walther Darré accueillit de nombreux disciples de Steiner dans son ministère.» Pour plus de détails, On pourra lire aussi cet article traduit en français de Peter Staudenmaier «Anthroposophie et écofascisme [50] » et d’autres articles en anglais [51] .
Wandervögel : Mouvement de jeunesse créé en 1896, hostile à l’industrialisation qui faisait l’apologie des valeurs teutoniques et du folklore germanique. Avant et pendant la première guerre mondiale ce mouvement connut plusieurs scissions autour de questions comme celles de l’homosexualité et de la mixité dans ses rangs. Plusieurs groupes se réclamaient des Wanderfögel avant 1933, et certains se rapprochèrent des scouts. Après leur prise du pouvoir, les nazis interdirent ces associations tout en récupérant leur organisation ultra hiérarchisée et leur idéologie nationaliste.
Deux remarques
Dans la troisième partie de «Le désert et les monstres», João Bernardo écrit : «Dans la mesure où ils étaient considérés comme des éléments qui voulaient subvertir l’ordre, le Troisième Reich assimilait les marxistes, communistes et socialistes aux Juifs, tout comme les Juifs, issus de “l’antirace”, étaient donc eux aussi des éléments subversifs. Le lieu approprié pour enfermer puis liquider “l’antirace” était les camps de concentration, où la prétendue circularité entre biologie et idéologie eut ses effets les plus tragiques, tout comme, pendant la guerre, les brigades mobiles d’extermination opérant dans les territoires conquis à l’Est confondirent souvent Juifs et marxistes dans la comptabilité du génocide. Comment les distinguer si, d’un côté ou de l’autre, ils appartenaient tous deux à “l’antirace” ?»
Ce passage m’a incité d’une part à introduire une précision sur ce que l’auteur appelle «les effets les plus tragiques» de la «prétendue circularité entre biologie et idéologie», effets qui se déroulèrent dans les centres de mise à mort (appelés autrefois «camps d’extermination») et non dans les camps de concentration qui ne furent pas le principal lieu de liquidation de «l’antirace» (d’ailleurs, l’auteur évoque lui-même ce qu’il est convenu d’appeler la «Shoah par balles» ; puis, je me suis interrogé sur la validité de l’hypothèse d’une «confusion» des nazis à propos de la prétendue «antirace», non pas dans leurs théories génocidaires mais sur le plan pratique, très concret, de l’extermination des Juifs, d’un côté, des communistes, de l’autre.
Sur la différence entre camps de concentration et centres de mise à mort
Il y eut de nombreux types de «camps», les frontières entre eux étant parfois mouvantes : les camps de travail forcé (camps de concentration), les camps de prisonniers et les camps de transit (généralement des antichambres pour l’extermination) [52]. En ce qui concerne les «camps d’extermination» (Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka II en Pologne) et les lieux qui combinaient les deux fonctions (concentration en vue de l’affectation à des travaux forcés et extermination, comme Auschwitz-Birkenau et Majdanek), on emploie désormais l’expression plus précise de centres de mise à mort, dans la mesure où les déportés juifs y étaient emmenés pour y être immédiatement tués et non détenus pendant une longue période.
L’expression de centres de mise à mort permet de ne pas les confondre avec les autres types de camps.
Comme l’explique le site de l’Holocaust Memorial Museum aux Etats-Unis : «Entre mars 1942 et novembre 1943, les SS et la police déportèrent environ 1 526 000 Juifs, la plupart par train, vers les centres de mise à mort de l’opération Reinhard : Belzec, Sobibor et Treblinka. Entre le 8 décembre 1941 et mars 1943, puis de nouveau en juin-juillet 1944, les SS et les fonctionnaires de police déportèrent environ 156 000 Juifs et quelques milliers de Roms et de Sinti vers le centre de mise à mort de Chelmno, par train, par camion et à pied. Entre mars 1942 et décembre 1944, les autorités allemandes déportèrent environ 1,1 million de Juifs et 23 000 Roms et Sinti à Auschwitz-Birkenau, la grande majorité par voie ferroviaire. Moins de 500 ont survécu aux centres d’extermination de l’opération Reinhard. Seule une poignée de Juifs a survécu aux transports vers Chelmno. Peut-être 100 000 Juifs ont-ils survécu à la déportation à Auschwitz-Birkenau parce qu’ils avaient été sélectionnés pour le travail forcé à leur arrivée.»
A ceux exterminés dans les centres de mise à mort, il faut ajouter la plus grande partie de ceux tués dans le cadre de la «Shoah par balles». Selon le site du Mémorial de la Shoah, «Entre 1941 et 1944, près d’un million et demi de Juifs d’Ukraine a été assassiné lors de l’invasion de l’Union soviétique par l’Allemagne nazie. L’immense majorité est morte sous les balles des Einsatzgruppen (unités de tueries mobiles à l’Est), d’unités de la Waffen SS, de la police allemande et de collaborateurs locaux. Seule une minorité d’entre eux l’a été après déportation dans les camps d’extermination.»
Sur la possible «confusion» entre la liquidation physique des communistes et l’extermination des Juifs en Allemagne et dans les territoires envahis par les nazis à l’Est
Je ne dispose pas de statistiques sur l’élimination physique des militants communistes dans toute l’Europe occupée et en URSS, donc je ne peux indiquer dans quelle mesure exacte Juifs et communistes furent «confondus», comme l’écrit l’auteur, par les nazis dans une seule «antirace» exterminable lorsqu’ils envahirent la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et l’URSS.
A) Pour ce qui concerne l’Allemagne, les données disponibles sont assez claires et cette affirmation me semble inexacte. Environ 60 000 militants communistes allemands (sur le million de membres du KPD) furent arrêtés sous le nazisme et 2 000 exécutés immédiatement en mars-avril 1933 ; certains restèrent emprisonnés jusqu’à la fin de la guerre ; d’autres furent libérés (notamment lors de l’anniversaire de Hitler le 20 avril 1939), de nouveau arrêtés pour des actes de résistance et condamnés à mort ; d’autres enfin furent fusillés longtemps après le début de leur incarcération en camp de concentration, jusqu’en avril 1945.
Je n’ai pas trouvé de statistiques spécifiques concernant les prisonniers politiques communistes (même au sens large, donc incluant les militants de la gauche antistalinienne) fusillés par les nazis en Allemagne, mais le total des prisonniers politiques allemands tués par les nazis n’excède sans doute pas les 77 000 personnes, toutes tendances confondues [53].
Selon Joachim Fest [54], trois millions d’opposants aux nazis furent arrêtés et emprisonnés entre 1933 et 1945 (et il ne fallait parfois pas grand-chose pour être catalogué comme un «opposant»). 225 000 opposants furent condamnés par la justice entre 1933 et 1939, majoritairement à des peines de prison et non à la peine de mort. B. Koehn considère qu’il y eut environ 600 000 «résistants [55]» (toutes tendances confondues) en Allemagne, soit 1% de la population. Et qu’environ 77 000 d’entre eux furent assassinés – «légalement» ou pas.
Il est difficile de faire coïncider les différents chiffres, tant ils se recoupent ou se contredisent : ainsi Gilbert Merlio (Les Résistances allemandes à Hitler, Tallandier, 2003) estime que 25 000 opposants furent condamnés à mort pendant la guerre, sur un total de 100 000 prisonniers politiques en 1942.
Mais jamais le régime nazi n’appliqua, en Allemagne, une politique d’extermination systématique contre ses opposants de gauche (ou de droite) non juifs, fussent-ils communistes. Les chiffres disponibles, aussi partiels soient-ils, sont là pour le prouver et ne souffrent aucune discussion.
Pour ce qui concerne les 525 000 Juifs allemands présents sur le territoire du Reich en 1933, environ 250 000 s’enfuirent avant d’être tués. Sur les 275 000 restants, environ 170 000 furent assassinés.
En Allemagne, la comparaison entre le nombre de communistes (si l’on prend le chiffre maximum de 77 000 sur un million) et le nombre de Juifs assassinés (environ 170 000 sur 275 000) montre bien la différence de traitement entre les uns et les autres, même si tous pouvaient être assimilés par les nazis à une «antirace». Soulignons que les nazis contrôlaient entièrement le territoire du Reich, possédaient tous les moyens pour ficher et arrêter tous les Juifs et tous les communistes, contrairement aux pays qu’ils envahirent où ils durent compter sur des supplétifs moins fiables, moins organisés, même s’ils étaient tout aussi fanatiquement antisémites et anticommunistes. Il me semble donc difficile d’affirmer qu’il y ait eu, en Allemagne, une «confusion» entre Juifs et communistes dans la politique concrète d’extermination, même si cet amalgame existait bien sûr dans la propagande réactionnaire, religieuse et nationaliste, depuis plus d’un siècle, si l’on prend en compte l’amalgame entre socialisme et judaïsme (ou judaïté), et la haine anti-juive de certains socialistes français, allemands, anglais, etc., dès les premières décennies du XIXe siècle.
B) Pour ce qui concerne les victimes non juives soviétiques et «slaves», donc les civils non combattants et les prisonniers de guerre soviétiques ou «slaves» morts à la suite des invasions hitlériennes en Europe orientale et en URSS, les chiffres disponibles ne permettent pas de savoir combien de communistes furent tués après 1941 par les nazis ou leurs supplétifs locaux.
Par exemple, l’Encyclopédie multimédia de la Shoah estime que les nazis ont tué (en dehors des Juifs) environ 1,8 million de Polonais (dont 50 à 100 000 personnes membres des élites polonaises) ; 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques [56] , 312 000 civils serbes et 5,7 millions de civils soviétiques [57] . Mais ces chiffres ne fournissent aucun détail sur les courants politiques auxquels appartenaient, ou pas, les victimes.
Il faut également savoir que le nombre officiel total des civils et des soldats soviétiques morts pendant la Seconde Guerre mondiale est passé de 7 millions en 1946, sous Staline, à 27 millions, en 1990, sous Gorbatchev [58] (rappelons que, en 1939, l’URSS comptait une population de 170 millions d’habitants). Par la suite, ces chiffres ont parfois été revus à la hausse par différents historiens ou spécialistes militaires russes, pour des raisons politiques évidentes. Quant aux historiens occidentaux, depuis 1945, ils ont fourni des estimations variées sur le nombre de civils soviétiques tués directement par les nazis ou morts à cause de leurs mauvais traitements (absence de soins, famines organisées, coups, tortures, etc.), mais nous garderons ici le chiffre le plus élevé, soit 18 millions de Soviétiques (Juifs compris).
Personne ne sait combien, parmi les (disons) 18 millions de victimes non-juives et juives de la guerre en URSS, étaient communistes, ou soupçonnées de l’être. On «sait» juste que les effectifs officiels du Parti communiste de l’Union soviétique passèrent de 3,4 millions à 5,76 millions entre 1940 et 1945, et que le Parti prétendit avoir recruté 3,8 millions de nouveaux membres pendant cette période. Malheureusement, les chiffres ne concordent pas : 3,6 + 3,8 = 7,4 millions de membres (et non 5,6 millions) à moins de penser qu’il y ait eu 7,4 – 5,6, soit 2,2 millions de communistes tués au combat… ou pas. Le mystère demeure.
Si l’on admet temporairement, pour les besoins de cette discussion, que ces chiffres sont exacts, le nombre de communistes soviétiques aurait singulièrement augmenté pendant les quatre années de guerre, ce qui ne fut pas du tout le cas des Juifs présents en URSS après l’invasion allemande, le 22 juin 1941 !
Comme l’explique Laurent Rucker, «sur les 3 millions de Juifs résidant à l’intérieur des frontières de l’URSS d’avant 1939, environ 1 million ont péri et sur les presque 2 millions (un chiffre précis de cette population demeure difficile à établir puisque les derniers recensements ont été effectués au début des années trente dans cinq États – les trois États baltes, la Pologne et la Roumanie- et à des dates différentes) qui vivaient dans les territoires annexés par l’URSS à la suite du pacte germano-soviétique – États baltes, partie orientale de la Pologne, Bessarabie et Bukovine du nord -, près de 80 % ont été exterminés (soit environ 1,6 million) [59] »
Peut-être est-il raisonnable de penser que les objectifs idéologiques de l’extermination de la prétendue «antirace» juive et des prétendus «sous-hommes» « slaves » (communistes ou pas) se confondirent avec des méthodes militaires classiques (semer la terreur en prenant des otages que les Waffen-SS ou la Wehrmacht tuaient régulièrement ; conquérir d’énormes espaces en bombardant à l’aveugle et en se livrant à des massacres de masse, etc.) sans que les nazis se soient souciés de vérifier si les millions de civils qu’ils tuaient, ou les millions de soldats soviétiques prisonniers qu’ils laissaient mourir de faim ou de maladie, étaient marxistes, socialistes, communistes – ou pas.
Pour conclure, la thèse avancée par João Bernardo d’une «confusion» des objectifs d’extermination des Juifs et des communistes, qui s’appuie sur les écrits des nazis, me semble fragile, dans son application pratique, d’abord évidemment en Allemagne, puis dans le reste de l’Europe : si généralement entre 50 et 90% des Juifs furent exterminés par les nazis en Europe orientale [60] et dans les territoires soviétiques occupés par l’armée allemande, jamais les communistes de ces mêmes pays ne furent décimés dans de telles proportions. En tout cas, aucun chiffre ne le prouve, à ma connaissance.
Cela ne tient évidemment pas à une quelconque indulgence des nazis à leur égard, mais à de nombreuses raisons historiques : fréquemment, les communistes étaient déjà dans la clandestinité avant l’invasion, ou la mise sous tutelle, de leurs pays respectifs ; ils n’étaient pas tous fichés par les polices locales et leurs fiches n’étaient pas toutes disponibles ; ils disposaient de vieilles traditions et techniques d’organisation clandestines puisqu’ils avaient généralement vécu dans des régimes autoritaires, voire fascistes, avant 1939 ; ils s’organisèrent parfois dans des groupes de partisans armés étaient donc plus à même de se défendre (comme en Pologne, mais surtout en Yougoslavie et en Grèce) ; ils étaient (parfois mais pas toujours) soutenus matériellement par l’URSS, voire par les Alliés, etc. Ce ne fut jamais le cas des populations civiles juives qui n’étaient ni habituées historiquement à s’organiser pour résister par la violence à la violence, ni armées idéologiquement et matériellement pour combattre. En revanche, leur identité et leur localisation étaient très faciles à trouver dans les registres d’état civil et autres archives officielles, voire dans les documents des communautés juives elles-mêmes.
Aussi macabres et inhumaines que soient cette comptabilité et cette comparaison, je suis obligé de conclure pour le moment que les projets nazis d’extermination ont eu des effets qualitativement différents sur les Juifs et les communistes durant la seconde guerre mondiale.
Notes
[1] Cette liste de «mots clés» a été ajoutée par mes soins (NdT).
[2] Pour les noms et les mots suivis d’un astérisque, prière de se reporter au Glossaire final établi par mes soins et dont l’auteur n’est pas responsable (NdT).
[3] Cf. son interview en français : https://soundcloud.com/vosstanie/entretien-avec-rita-delgado-militante-revolutionnaire-internationaliste, enregistrée en 2021 (NdT).
[4] Précision de João Bernardo apportée dans un débat avec les internautes : «Je ne crois pas que les grandes transformations de régime soient dues à des choix faits par les dirigeants. Lorsque de tels choix sont faits, la transformation est déjà bien avancée dans la pratique. En fait, ce qui ressemble à un choix est une reconnaissance plus ou moins tardive de la situation pratique. C’est ce que j’ai voulu dire dans ce texte : l’économie planifiée ne fonctionnait que parce qu’il y avait une économie parallèle pour lui donner la malléabilité nécessaire ; la tentative de réconcilier officiellement les deux systèmes a échoué, parce que l’un dépérissait et que l’autre se développait ; et l’effondrement du régime soviétique a été la reconnaissance d’un fait qu’il était déjà impossible de dissimuler.»
[5] Cet ouvrage obtint le prix Goncourt en 1960 mais le jury ne put le décerner à l’auteur parce que le PCF révéla dans sa presse le passé fasciste d’Horia (NdT).
[6] Cf. João Bernardo : «Le Brésil n’est pas au Brésil, il est dans le monde» https://npnf.eu/spip.php?article723 et Passa Palavra : «Face au Coronavirus au Brésil : Voulons-nous une “démocratie prolétarienne” de zombies ?» https://npnf.eu/spip.php?article709 (NdT).
[7] Cf. João Bernardo, Labirintos do fascismo, 6 volumes, Hedra, 2023, dernière édition (NdT).
[8] Cf. l’article de João Bernardo «L’agriculture familiale et le nazisme» (https://npnf.eu/spip.php?article331) inclus dans le recueil de João Bernardo Contre l’écologie, Éditions Ni patrie ni frontières, 2018 (NdT).
[9] Cf. les articles de Peter Staudenmaier : «Organic Farming in Nazi Germany: The Politics of Biodynamic Agriculture, 1933-1945» (2013) ; «Fascist Ecology: The “Green Wing” of the Nazi
Party and its Historical Antecedents» (2011); et, ce dernier texte qui porte sur la défense des paysages : «Advocates for the Landscape: Alwin Seifert and Nazi Environmentalism» (2020), disponibles sur le site https://epublications.marquette.edu/hist_fac (NdT).
[10] Dans une réponse à un lecteur (cf. p. 10), l’auteur précise qu’il ne critique pas la science de l’écologie mais les conceptions politiques et philosophiques des mouvements écologistes (NdT).
[11] Publié en français par les Éditions Ni patrie ni frontières, 2018 (NdT).
[12] https://npnf.eu/spip.php?article329 (NdT).
[13] «Je nomme plus–value absolue la plus–value produite par la simple prolongation de la journée de travail, et plus–value relative la plus–value qui provient au contraire de l’abréviation du temps de travail nécessaire et du changement correspondant dans la grandeur relative des deux parties dont se compose la journée» (Karl Marx, Le Capital, Livre I), NdT.
[14] Cf. João Bernardo, «Écologistes et antivax… même combat» (2021), https://npnf.eu/spip.php?article872 (NdT).
[15] Le titre complet de cet ouvrage non traduit en français est : Pouvoir et argent – du pouvoir personnel à l’État impersonnel dans le régime seigneurial. Selon la présentation de l’éditeur : «Cet ouvrage se propose de montrer, en trois volumes, comment les institutions familiales ont été réorganisées dans le régime seigneurial, servant finalement de cadre à un exercice impersonnel du pouvoir. Avec la grande crise sociale et économique de la seconde moitié du XIVe siècle, on inaugure un système où la domesticité du monarque, élargie à l’échelle du royaume tout entier et rendue impersonnelle dans ses modes de relation, devient l’État moderne. L’évolution des autres types de famille est subordonnée à cette transformation décisive. Dans le même but, les formes modernes de la monnaie se sont développées, rendant possible le fonctionnement impersonnel de l’État. Ce système de pouvoir et ces formes de monnaie ont ensuite servi de matière première aux institutions du capitalisme, qui leur ont donné d’autres fonctions et une autre signification en les insérant dans la structure du nouveau mode de production. Le premier volume analyse la période du VIe au IXe siècle, durant laquelle le pouvoir personnel prévaut, ainsi que les institutions familiales qui le sous-tendent et les types de monnaie qui le soutiennent. Le deuxième volume étudie les conflits sociaux et les tensions sociales qui ont transformé l’économie esclavagiste du Bas-Empire en un régime seigneurial et qui ont ensuite précipité, aux IXe et Xe siècles, la crise de cette forme de régime seigneurial, en le restructurant sous de nouvelles formes entre les XIe et XIVe siècles. Ce processus a accompagné la transformation du pouvoir personnel en pouvoir impersonnel. Le troisième volume est consacré à l’analyse des systèmes familiaux qui ont constitué le cadre de l’exercice du pouvoir impersonnel entre le XIe et le XIVe siècle et des formes de monnaie qui ont servi de véhicule à ce mode de pouvoir» (Afrontamento, 3 volumes, 1996-2002), NdT.
[16] Cf. Pablo Poblese : «Théorie des privilèges, identitarisme et développement du capitalisme» (2020, https://npnf.eu/spip.php?article997) et «La politique identitaire d’Ifood» (2021, https://npnf.eu/spip.php?article946) (NdT).
[17] En français, ce terme est considéré comme plus péjoratif que celui de métissage, même s’il a le même sens. Sur les origines de ce mot, on lira l’article de George Frederickson, «Mulâtres et autres métis. Les attitudes à l’égard du métissage aux États-Unis et en France depuis le XVIIe siècle» (2005), https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-1-page-111.htm (NdT).
[18] Que João Bernardo se «rassure», les partisans de l’idéologie trans, avides de prouver que le sexe serait un «spectre» illimité, citent souvent l’exemple des vers, des huîtres, des tortues, des poissons (mérous, tilapias, labres, poissons-clowns), voire des crocodiles, même si ces derniers ne sont pas (encore) des animaux domestiques (NdT).
[19] Sur ce sujet, on pourra lire la première partie d’un autre texte de João Bernardo, «Peut-être» (https://npnf.eu/spip.php?article965, 2022), et, à la fin, ses réponses à mes remarques critiques (NdT).
[20] Regards sur le monde actuel [Stock, 1931], Folio, 1988, disponible aussi sur le site classiques.uqac.ca (NdT).
[21] Cf. João Bernardo, «Le KPD et l’extrême droite nationaliste», troisième partie de Marxisme et nationalisme, https://npnf.eu/spip.php?article920 (NdT).
[22] Cf. ces articles de João Bernardo : «Un De profundis pour la gauche. Huit thèses sur l’effondrement de la gauche» (https://npnf.eu/spip.php?article910); « Fascisme ou stupidité ? » (https://npnf.eu/spip.php?article919) ; «Ukraine. Avant et après» (https://npnf.eu/spip.php?article942) ; «Ukraine : Bang ! Bang ! pffff… Brrroum ?» (https://npnf.eu/spip.php?article972) ; et Pablo Stefanoni : «Contre la gauche “tankiste”» (https://npnf.eu/spip.php?article907), NdT.
[23] Ayant vécu et milité durant de nombreuses années au Brésil, João Bernardo vise en particulier le «mouvement noir» brésilien dont Djamila Ribeiro est l’une des représentantes. Pour plus de détails, on pourra lire le livre de João Bernardo L’autre face du racisme (Éditions Ni patrie ni frontières, 2022) et les annexes de cet ouvrage qui incluent plusieurs articles parus sur le site Passa Palavra à propos des mouvements d’Afrodescendants au Brésil et sur le Front noir brésilien, organisation afrobrésilienne, à la fois antiraciste et protofasciste (NdT).
[24] Cf. Passa Palavra : «Le racisme noir contre les Noirs en Afrique : un douloureux paradoxe de la lutte des classes» (https://npnf.eu/spip.php?article808) ; «Ouvrez les yeux sur l’Afrique !» (https://npnf.eu/spip.php?article807), NdT.
[25] L’évolution politique de Kemi Seba, qui est passé du rôle d’agitateur franco-béninois, faux «anti-impérialiste» mais vrai antisémite en France, à celui d’agent stipendié de Poutine et de la milice Wagner en Afrique, l’illustre parfaitement : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230403-le-militant-panafricaniste-kemi-seba-r%C3%A9pond-%C3%A0-une-enqu%C3%AAte-journalistique-sur-ses-liens-avec-wagner. Et symptomatique est l’admiration qu’il suscite chez certains étudiants africains en France, futurs membres de la classe dirigeante dans leur pays :
[26] Cf. le livre de João Bernardo et Manolo, De retour en Afrique. Des révoltes d’esclaves au panafricanisme (Éditions Ni patrie ni frontières, 2016). La citation de Marcus Garvey à laquelle João Bernardo fait allusion est la suivante : «Nous avons été les premiers fascistes. Nous avons discipliné des hommes, des femmes et des enfants en formation pour la libération de l’Afrique. Les masses noires ont compris qu’elles pouvaient placer leurs espérances dans ce nationalisme radical et le soutenir sans réserve. Si Mussolini m’a plagié avec le fascisme, les réactionnaires noirs, eux, l’ont saboté.» (NdT).
[27] Principe (ou loi) selon lequel un système isolé qui a subi une évolution ne peut plus revenir à son état initial (NdT).
[28] Organisée par la revue Historical Materialism et le site homonyme (NdT).
[30] Sur le sens de ce terme baroque, cf. par exemple Boaventura de Sousa Santos, «Épistémologies du Sud», Études rurales, n° 187, 2011, http://journals.openedition.org/etudesrurales/9351 ) (NdT).
[31] Sur cette révolution oubliée, on pourra lire les nombreux textes traduits dans cette rubrique : https://npnf.eu/spip.php?rubrique137 (NdT).
[32] Cf. les deux articles de João Bernardo en portugais : «Para uma historiografia do Não» (https://passapalavra.info/2022/05/143354/) et «Em do busca do Não» (https://passapalavra.info/2022/06/143972/). Et en français : «Propositions pour une méthodologie de l’histoire» (https://npnf.eu/spip.php?article893), NdT.
[33] Cf. G.W. Leibnitz, De l’origine radicale des choses (1697, disponible en ligne) : «Mais pour expliquer un peu plus clairement comment des vérités éternelles ou essentielles et métaphysiques naissent les vérités temporaires contingentes ou physiques, nous devons reconnaître que, par cela même qu’il existe quelque chose plutôt que rien, il y a dans les choses possibles, c’est-à-dire dans la possibilité même ou dans l’essence un certain besoin d’existence, et pour ainsi dire, quelque prétention à l’existence, en un mot que l’essence tend par elle-même à l’existence. Il suit de là que toutes les choses possibles, c’est-à-dire exprimant l’essence ou la réalité possible tendent d’un droit égal à l’existence selon leur quantité d’essence réelle, ou selon le degré de perfection qu’elles renferment : car la perfection n’est rien autre chose que la quantité d’essence.» (NdT)
[34] Le Parti d’Edgar Winger, NRF, Gallimard, 2022 (NdT).
[35] Cf. l’article de Traian Sandu, «La Garde de Fer : méthodes de mobilisation et d’encadrement», https://hal.science/hal-00674245/file/Sandu_Garde_de_Fer-mobilisation_et_encadrement.pdf . (NdT)
[36] Franco Gaeta, Dizionario biografico degli Italiani, volume 29, Treccani, 1983. (NdT)
[37] Idem. (NdT)
[38] Idem. (NdT)
[39] Idem. (NdT)
[40] Idem. (NdT)
[41] Ces phrasees furent prononcées après l’invasion italienne de l’Ethiopie, et citées par Joel A. Rogers dans «Marcus Garvey», série Negroes of New York, New York Writers Program, 1939. [J.A. Rogers était un journaliste et historien autodidacte jamaïcain qui connaissait bien Garvey, partageait ses positions panafricanistes et écrivit dans plusieurs de ses publications.] Sur les positions de Garvey vis-à-vis de Hitler et Mussolini, on pourra lire l’article nettement plus clément, de Francine M. King: «Marcus Garvey’s views of fascism as they relate to the Black struggle for equal rights : an analysis of commentaries from The Black Man 1935-1939» qui contient néanmoins de nombreuses citations profascistes même si elles sont antérieures à 1937 (https://omowalebooks.files.wordpress.com/2020/07/garvey-hitler.pdf); et la traduction de l’article fondamental de Paul Gilroy, «Black Fascism (fascisme noir)», https://npnf.eu/spip.php?article586. (NdT)
[42] Ceux qui s’intéressent à la façon dont un (ou une) universitaire peut minimiser les écrits profascistes et antisémites d’un écrivain trouveront dans cet article paru sur le site du « Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes » ( https://publications-prairial.fr/larhra/index.php?id=122 ) les procédés les plus communément utilisés : 1) le gentil Horia était jeune ; 2) il régnait une sorte d’«antisémitisme d’atmosphère» auquel il n’a pas pu résister ; 3) certains ont été bien pires que lui (ici, Ionesco, Cioran, etc., dont l’adhésion à la Garde de fer est incontestable) ; 4) les méchants communistes ont monté un dossier contre lui dont certains éléments ne sont pas vérifiables, voire inexacts, donc c’est une pauvre victime du totalitarisme ; et 5) cerise sur le gâteau, il a été mis dans un camp de concentration par les nazis, donc il n’était pas vraiment fasciste ! (NdT)
[43] João Bernardo, Ils ne savaient pas encore qu’ils étaient fascistes, Éditions Ni patrie ni frontières, 2022. (NdT)
[44] Selon A.L. Araujo et F. Saillant (2009), cette expression apparaîtrait dévalorisante à certains pardos brésiliens qui préféreraient se nommer Afro-Brasileiros – ou Negros, pour les plus politisés. (NdT)
[45] G.A. Andrew, «Inégalité raciale au Brésil et aux États-Unis : comparaison statistique» (2014), https://journals.openedition.org/bresils/917 . Selon cet auteur, les revenus des pardos et des pretos étaient assez proches dans les années 1980 (les statistiques n’étaient et ne sont guère développées sur ce sujet, vu la prégnance du mythe de l’exceptionnalisme brésilien et de sa «démocratie raciale»), même s’il existait des disparités entre métis et noirs. Et le fossé social majeur séparait ces deux catégories des Eurodescendants. (NdT)
[46] Cité par Ana Lucia Araujo, Francine Saillant, décembre 2009, dans «Qui est Afro-Brésilien ? Ethnographie d’un débat d’identité au sein d’une communauté virtuelle», (https://www.ethnographiques.org/2009/Araujo-Saillant). (NdT)
[47] Cf. le livre d’Edith Bruder, Black Jews. Les Juifs noirs d’Afrique et le mythe des Tribus perdues, Albin Michel, 2014. (NdT)
[48] https://www.dailymotion.com/video/x2c5rdu . Or, le révolutionnaire Toussaint l’Ouverture était un «nègre de maison», ce que visiblement Malcolm X ignorait ! Ces divisions raciales fictives, déjà établies de longue date par les peuples locaux, ou introduites par les colonisateurs européens, ont favorisé la domination impérialiste dans tous les pays du tiers monde et se perpétuent en 2023, longtemps après la victoire des indépendances, pour favoriser telle ou telle clique politique (partis, mouvements de libération, ou, plus récemment, groupes djihadistes). (NdT)
[49] João Bernardo, «Postscriptum contre l’écologie» (2013), https://www.academia.edu/ et dans le livre Contre l’écologie (2018), Éditions Ni patrie ni frontières, 2018. (NdT)
[51] Cf. Peter Staudenmaier: «Rudolf Steiner and the Jewish Question» (2005) ; «Race and Redemption: Racial and Ethnic Evolution in Rudolf Steiner’s Anthroposophy» (2008), disponibles en ligne. (NdT)
[52] Le Mémorial de la Shoah aux Etats-Unis en 2013 a recensé en Europe : «1150 ghettos juifs, 30000 camps de travaux forcés, 980 camps de concentrations, 1000 camps remplis de prisonniers de guerre» : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/03/05/01016-20130305ARTFIG00553-une-etude-revoit-a-la-hausse-le-nombre-de-camps-nazis.php. Plus de détails en anglais ici : https://www.ushmm.org/research/publications/encyclopedia-camps-ghettos (NdT)
[53] Selon Barbara Koehn, La résistance allemande contre Hitler, PUF, 2003. (NdT)
[54] La résistance allemande à Hitler (1994), traduction française Perrin (2009). Réédition Tempus (2013). (NdT)
[55] Le plus souvent, résister, sous la dictature nazie, ne prenait pas des formes spectaculaires : renâcler à adhérer aux Jeunesses hitlériennes, au NSDAP ou aux différentes associations créées par le régime ; éviter de faire le salut nazi ; émettre des doutes ou faire des plaisanteries sur l’infaillibilité de Hitler ; invoquer l’Ancien ou le Nouveau Testament comme source de principes moraux ; lire et faire lire des livres interdits ; refuser d’organiser des autodafés dans les universités, etc. Tous ces actes étaient considérés comme de la «résistance», au même titre que de distribuer des tracts, publier des journaux clandestins, peindre sur les murs des slogans hostiles au régime, cacher des Juifs ou des opposants recherchés par la Gestapo, ou… préparer des attentats. (NdT)
[56] Dans Terres de sang, Timothy Snyder avance le chiffre de 3,5 millions de prisonniers de guerre soviétiques. (NdT)
[57] Source : https://encyclopedia.ushmm.org/content/fr/article/documenting-numbers-of-victims-of-the-holocaust-and-nazi-persecution) (NdT)
[58] C’est d’ailleurs ce dernier chiffre que met en avant ce sites de guides du Musée de la Grande Guerre patriotique : https://bridgetomoscow.com/fr/musee-de-la-grande-guerre-patriotique . (NdT)
[59] https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-shoah-2002-1-page-59.htm#no8 (NdT)
[60] En Pologne, par exemple, 2,9 millions de Juifs disparurent, sur les 3,3 millions que comptait le pays. On trouvera les pourcentages, par pays, ici : https://www.memorialdelashoah.org/archives-et-documentation/quest-ce-que-la-shoah/questions-frequentes.html. Notons que, dans cette liste de pays européens (plus large que l’Europe orientale), le pourcentage concernant l’Allemagne est bizarrement minoré, puisqu’il est établi sur la base de la population juive de 1933, et pas sur ceux qui sont effectivement restés sur le territoire du Reich durant toute la guerre, soit environ 275 000 sur 525 000, auquel cas le pourcentage d’extermination n’est pas de 25 % mais de 75% ! Cette remarque est d’ailleurs en partie valable pour les autres pays cités (NdT).






